Journal philosophique
(23 - 11 - 2014)
« Ceci n’est pas un journal » -

En effet, ce qui suit ne sera pas un « journal » à bien des égards. J’entends par là qu’on n’y trouvera rien d’intime ou d’autobiographique. Rien donc qui puisse s’apparenter à l’introspection ou bien à l’héroïsation de mes propres affects. Je n’en vois tout simplement pas l’intérêt.
C’est pourtant une tendance, la philosophie de l’émoi. Il y a quelques temps, je suis tombé sur l’incipit d’un essai : le type – un « nouveau philosophe » - expliquait qu’il avait appris à pleurer en regardant une série américaine (Six feet under). Son psy ou sa mère ont dû toucher l’absolu. Cela dit, on en a vu d’autres capables de phénoménologiser leur cancer ou bien leur amour avec des nymphettes qui avaient l’âge de leur arrière-petite fille. C’est pathétique de constater à quel point on peut se faire croire à soi-même, à force d’en avoir fait profession, que tout peut être sauvé par la pensée et recevoir ainsi une apparente dignité. N’est pas Rousseau, Kierkegaard ou Nietzsche, qui veut. Mais enfin je suis un consommateur démocrate : si cela trouve un public.
En tout cas, ce n’est pas mon chemin. La pensée est une aventure. Elle vous conduit loin de vous-même. C’est là tout son prix. Peut-être aura-t-on raison d’y voir une fuite névrotique. Mais quitte à prêter le flanc à la psychanalyse de bazar, je préfère ce joli mot : la fugue. Penser, c’est fuguer. Walter Benjamin avait, comme toujours, une parole fulgurante pour l’une et je suis sûr qu’il parlait aussi de l’autre à l’occasion : « Celui qui n’a jamais fugué ne saura jamais ce qu’est le cristal du bonheur ».
Il y a aussi une autre façon de tenir un « journal » : à la manière des journalistes. Façon pour la philosophie de s’excuser de ce qu’elle est ou de ce qu’on l’accuse d’être : absconse, abstraite, lointaine, hautaine. On se fait fort alors de penser le « réel », le petit, le factuel, l’insignifiant.
C’est certainement une question légitime – une question que tout penseur devrait se poser-, celle de savoir quel objet on élève à la pensée (et pour quelles raisons) et, inversement, ce que l’on ignore ou méprise. En ce sens, quand Platon, par la bouche de son Parménide, se demande pourquoi on ne pourrait pas reconnaître une essence de la boue ou du poil, il se pose à lui-même une question décisive, la question que Nietzsche lui posera : toute ontologie ne dissimule-t-elle pas une axiologie ? Notre volonté de vérité manifeste-t-elle autre chose qu’un désir d’ordre selon l’ordre de nos désirs ? L’Etre n’est-il donc que notre norme ? Platon fait dire ici à son Parménide une parole fidèle au Poème, à une ontologie parménidienne qui se refusait à toute hiérarchie de l’Etre ainsi qu’à toute réduction de l’Etre au logos. Or, c’est cela même que Platon cherche à édifier : la première de toutes les métaphysiques ; c’est pourquoi il trahit Parménide et esquive cette question.
Il peut s’avérer crucial en ce sens de demander raison à tout penseur du privilège qu’il accorde à certains objets, le privilège d’être pensés. Et inversement, de se demander quel peut être pour ce penseur la boue ou le poil qu’il ignore ou qu’il méprise. Je me demande si la plus révélatrice des histoires de la philosophie ne consisterait pas ainsi à poser cette question à chaque penseur, si on n’apprend pas quelque chose de plus essentiel sur un penseur en se demandant non pas ce qu’il pense mais ce qu’il exclut hors du domaine de sa pensée.
Alors, certes, évitons toute précipitation, surtout en matière de mépris. Et toute pensée authentique doit sans doute se méfier bien plus de ce qui s’impose à elle comme objet signifiant que de ce qu’elle estime relever du non-sens.
Maintenant, que l’on prétende appliquer la philosophie aux catégories
prédéterminées de la niaiserie quotidienne relève de la bouffonnerie
(commerciale). Il y a quelque temps de cela, le journal « Libération » avait
proposé ainsi un numéro spécial entièrement rédigé par des « philosophes ».
Idée intéressante, sauf que lesdits penseurs avaient dû plier leurs concepts
aux rubriques habituelles : sport, météo, tourisme,…Désopilant. J’aurai la
décence de ne pas parler ici de la philosophie pliée à la logique du
magazine.

Philosophie du chien donc, du rat, de la belette, et philosophie d’Astérix, de Matrix, du rock, du rap, philosophie de mes glaires, de tes larmes, et puis spinozisme de Robert Bresson, bergsonisme de Louis de Funès, Kant et ma mère, Kant et mes ulcères, Sur l’impuissance de Nietzsche et Pour une phénoménologie du IIIème arrondissement, etc., etc., etc…
Coupons là. C’est si facile. Mais il fallait prévenir tout malentendu.
A la suite, vous trouverez des notes, des fragments, des pistes de recherche : autant d’intuitions que j’abandonnerai délibérément en l’état, comme des lignes de fuite. Mon ambition n’est nullement de prétendre à la grande pensée fragmentaire (celle d’un Nietzsche par exemple), mais de susciter un dialogue, même si, sur ce point, je suis fort naïf de rêver encore à une « République des Lettres », idée à laquelle notre époque n’est pas simplement étrangère mais hostile. Dans tous les cas, il n’y a aucune imposture à essayer de penser. Ni aucun ridicule. C’est un risque qu’il faut savoir courir, au contraire, tant que l’on est vivant.
(05-01-2015)
Le grand renfermement platonicien (1) –
Le procès du « père » a déjà eu lieu bien des fois. Mais ce procès est nécessaire car il faut que l’on sache exactement, à la fin, de quoi nous sommes redevables à Platon. A force d’identifier la philosophie à la pensée grecque, nous avons effacé l’allure dissidente de cette pensée, ne situant sa différence que là où elle nous invitait elle-même à la reconnaître, dans l’opposition aux sophistes. Or, ce cercle de craie que dessine la pensée platonicienne est un leurre : la dialectique ne s’oppose à la sophistique que sur le fond d’une entente primordiale, celle du rejet de la pensée archaïque. Car c’est cette pensée que Platon met délibérément hors-jeu, déployant sa dialectique sous les auspices d’une fausse origine, le combat avec les sophistes, afin de mieux se dérober à ce combat, plus décisif celui-là, plus périlleux aussi, qui pourtant, s’il l’avait accepté honnêtement, aurait donné à sa pensée une allure moins convenue. A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Bien sûr, de la pensée archaïque, il est question dans les Dialogues, mais comment en est-il question ? Cette pensée est systématiquement déplacée par Platon, absorbée ou bien rejetée, avec – disons-le – une nonchalance extraordinaire, dans le domaine d’une pensée « naturelle », quasi inarticulée, celle du mythe. Ainsi, le Parménide avec lequel Platon débat est un Parménide déjà converti à la pensée platonicienne, qui est déjà dans l’entente des catégories platoniciennes de l’Etre. Autrement dit, ce n’est pas Parménide.
Seulement, le tour de force de Platon est de prescrire les conditions et les limites dans lesquelles la pensée est tenue désormais de s’exercer et l’allure dialogique ne doit pas nous tromper. La dialectique platonicienne est la première épistémologie moderne : elle donne à la connaissance la forme d’une configuration d’un territoire de sens, où la limite et l’exclusion déterminent de façon décisive le champ du savoir, où les catégories discriminantes (le Même- l’Autre, l’Un- le Multiple, etc.) deviennent, pour la première fois, des conditions fondamentales de la vérité. C’est là la nouveauté proprement platonicienne : l’affirmation d’une forme de vérité inédite, fondée sur un procès de discrimination capable de produire un ordre logique et hiérarchisé, qui soit non pas simplement substituable à l’Etre donné, à ce qui existe bel et bien, mais plus encore qui puisse s’affirmer comme premier par rapport à l’existence. Idées et essences inaugurent ainsi le temps de la connaissance moderne, celui d’une connaissance opératoire qui décrète le réel, où l’intellect produit les conditions selon lesquelles les choses sont tenues d’apparaître. Platon est, en ce sens, le fondateur de l’ontologie et de la métaphysique moderne : ontologie, c’est-à-dire une pensée de l’Etre avant l’Etre, la pensée non de ce qui est mais de l’Etre de ce qui est, pensée de ce qui est réellement, de ce qui est authentiquement, d’un Etre redoublé, opposé à lui-même et auquel l’existence est accidentellement apposée. Ce logos de l’Etre se signifie exclusivement comme l’Etre du logos. Que cette ontologie nous fasse courir le risque d’être entraînés dans le vertige d’une antériorité qui jamais ne prendrait fin (l’argument du troisième homme) importe peu finalement, car c’est par cela que cette pensée de l’Etre se justifie : l’antériorité par rapport à toute existence donnée. Ce faisant, la philosophie platonicienne ordonne le geste fondateur de la science à venir, à savoir : déposer l’existence de « ses droits », de sa primauté, de son éclat, de sa beauté. L’ambiguïté d’une telle science n’échappera pas à Nietzsche, lui qui souligne que cette connaissance du réel, parce qu’elle se fonde sur une ontologie discriminante, couvre et couve, sous des exigences d’apparente rigueur, de probité intellectuelle ou d’objectivité, une axiologie qui ne veut pas dire son nom, faisant ainsi de la vérité non pas l’étalon de toutes les valeurs, mais une valeur parmi d’autres et celle qui, parmi toutes, manifeste le plus le perspectivisme de la vie, vie qui réclame avant tout des interprétations capables de satisfaire nos instincts.
Si je m’autorise ainsi à reprendre le concept de « renfermement », propre à la philosophie de Foucault, pour l’appliquer à la pensée platonicienne, c’est parce que ce concept permet de prendre la pleine mesure de la rupture qu’engage la philosophie à ses origines avec la pensée et l’expérience archaïque du monde. Ce « grand renfermement », dont la philosophie (de Platon) est le nom, est double : un renfermement épistémique, l’Etre étant désormais enfermé dans le logos, l’existence et le monde, méprisés ; un renfermement politique, l’homme étant désormais enfermé dans la Cité, l’ambiguïté tragique de l’existence humaine désormais ignorée. Il n’est question pour l’instant que du premier aspect de ce « grand renfermement », de son versant épistémique. Du versant politique, il sera question plus tard.
Ce renfermement épistémique, comme nous le soulignions, consiste pour Platon à réduire l’Etre au logos. Exit l’existence. Monique Dixsaut dans un article lumineux, Platon et le logos de Parménide (in Etudes sur Parménide, Vrin, 1987) reconnaît bien dans cette détermination logique de l’Etre par Platon le point de rupture avec la pensée parménidienne. Telle qu’elle le souligne, tout le débat du Sophiste consiste en effet à mettre en question une conception référentielle et existentielle de l’Etre, qui interdirait au logos d’en déterminer exclusivement la signification à partir de lui-même. Avec Platon, l’Etre devient un concept et l’existence, un mythe. Est en effet mythos pour Platon, et non logos, la parole qui fait signe vers l’existence et qui tire son sens de cette monstration, sans interroger la signification des termes du discours. C’est là ce qui sépare fondamentalement Platon de Parménide car, comme le ponctue Monique Dixsaut, « pour l’avoir oublié le logos du Père [Parménide] est au regard de Platon un mythe, une Parole trop proche de ce qu’elle dit pour pouvoir s’interroger sur ce qu’elle veut dire : elle est, si l’on peut dire, réifiée, et comme transie par son message ».
Cette décision ontologique de Platon est clairement signifiée par Socrate dans un passage du Phédon : « J’ai craint que mon esprit ne fût totalement aveuglé si je regardais les choses avec mes yeux et si j’essayais d’entrer en contact avec elles. Il me sembla dès lors que je devais me réfugier du côté des discours et chercher en eux la vérité des choses » (99e2). Qui veut prendre ici la portée du geste platonicien doit le comparer à l’élan panique vers l’Etre qui anime le Poème de Parménide.
Je veux rassembler à la suite quelques analyses sur la position de Parménide (que l’on retrouvera dans l’essai que je lui ai consacré, Parménide, le Poème incompris) afin de bien mesurer la façon dont la philosophie rompt avec la pensée archaïque. Au fil du Poème se dessine un certain art de la parole, selon qu’on la destine à la vérité de l’être ou bien qu’on l’avilisse en la réduisant à un bel ordre discursif, le simple « arrangement trompeur » du discours, ordre vain, parole qui erre, parce qu’elle a perdu la finalité qui lui donne sens : dire ce qui est. En ce sens, Parménide pose la question suivante : qu’est-ce qui confère sa force à la parole ? Et il s’agit bien pour lui de refuser le discours dont l’hubris serait de croire qu’il peut tirer sa persuasion de lui-même, de « l’enchantement » de son « ordre harmonieux » (VIII, 53-54). S’il est donc urgent de retrouver la Voie de l’être pour Parménide, c’est que cette voie est aussi celle d’une parole qui garde un sens. Et Parménide de nous prévenir : qui proclamera la souveraineté de la logique, qui croira faire du discours sa propre norme de vérité, qui fera de l’être une simple catégorie logique ou grammaticale, celui-là devra – tôt ou tard – affronter l’insignifiance de sa propre parole, d’une parole qui ne sait plus ce qu’elle dit. Qui enferme l’Etre dans le logos, au lieu de voir, d’entendre et dire ce qui est, finit par « mouvoir un œil sans but, une oreille et une langue retentissante d’échos » (VII). Dès lors, si l’on veut parler d’une « ontologie » parménidienne, ce ne peut être au sens d’une logique qui, dans son ordre même, pourrait décider de l’être ; la seule ontologie véritable consiste au contraire à soumettre notre logique à l’ordre du monde. L’étrange déclaration de l’Etre par la Déesse parménidienne en rassemble la décision : « Esti ». Dire « Est », et non « l’Etre » ou « il est », est une façon d’interrompre le mouvement du discours, de tout discours, qui, immanquablement, attribue, particularise, scinde l’unité de l’être, le décompose logiquement, l’épelle et l’articule, puis finit par l’opposer à lui-même. Mais c’est aussi refuser l’arrêt, la réification dans « l’être », la transformation de l’être en une substance et son absolutisation dans un au-delà de toute présence. « Esti » : Ni dieu, ni concept, l’être est l’acte de l’existence.
« L’être est ». Faute de l’avoir compris, la tradition a lu la
déclaration parménidienne comme la lit Platon : seul l’être est.
Or, cette différence ontologique, qui ouvre le procès métaphysique de
l’existence (et plus encore son rejet dans l’indifférence et le mépris),
c’est justement à Platon que nous la devons. Avec Platon, l’être devient
l’auto-ipséité qui fonde la connaissance de toutes choses, faisant du
logos le principe de toute vérité contre l’existence sensible. Ainsi, la
pensée platonicienne soumet intégralement l’être à la connaissance, tel
qu’ainsi, désormais, rien ne mérite le nom d’être sinon ce qui est
connu, ce qui possède son identité à soi-même, au point que la
« réalité » finit par se confondre avec l’ipséité logique et n’est plus,
dès lors, la voie d’accès à l’être, mais le lieu où il réside
exclusivement. De Platon à Hegel, ce primat de la réalité sur
l’existence ne fera que s’affirmer jusqu’à consumer l’être entièrement,
réduit à n’être qu’une simple fumée logique, la réalité n’étant plus à
rechercher ailleurs que dans l’auto-déploiement du concept.
différence ontologique, qui ouvre le procès métaphysique de
l’existence (et plus encore son rejet dans l’indifférence et le mépris),
c’est justement à Platon que nous la devons. Avec Platon, l’être devient
l’auto-ipséité qui fonde la connaissance de toutes choses, faisant du
logos le principe de toute vérité contre l’existence sensible. Ainsi, la
pensée platonicienne soumet intégralement l’être à la connaissance, tel
qu’ainsi, désormais, rien ne mérite le nom d’être sinon ce qui est
connu, ce qui possède son identité à soi-même, au point que la
« réalité » finit par se confondre avec l’ipséité logique et n’est plus,
dès lors, la voie d’accès à l’être, mais le lieu où il réside
exclusivement. De Platon à Hegel, ce primat de la réalité sur
l’existence ne fera que s’affirmer jusqu’à consumer l’être entièrement,
réduit à n’être qu’une simple fumée logique, la réalité n’étant plus à
rechercher ailleurs que dans l’auto-déploiement du concept.
En posant la question de l’être de l’existence, autrement dit en interprétant la question de la vérité exclusivement sur le mode du connaissable, la métaphysique allait peu à peu considérer l’existence elle-même comme un fait contingent. La Critique de la raison pure n’est ainsi, à bien y penser, qu’une façon de liquider une fois pour toutes l’existence en en faisant (habilement) une limite de la connaissance pour mieux autoriser cette dernière à se définir par elle-même sans se soucier de ce qui est, hors des catégories de sa propre expérience. « La chose en soi » est un « chacun chez soi » : et si les ontologies classiques se débattaient encore avec la question de l’être en cherchant à subsumer logiquement l’existence, Kant trouve la solution la plus économique qui soit ; « chacun chez soi » donc, séparons la question de la vérité et celle de la réalité, affirmons l’ipséité du logos et du sujet en reconnaissant l’ipséité de l’être, enfermons l’être dans l’en soi pour qu’il cesse de troubler l’ordre de la connaissance. En ce sens, le génie de Kant consiste à supprimer le problème afin de le résoudre. Si les métaphysiciens se désespéraient encore d’une véracité qu’ils ne savaient où suspendre, Kant la réduit à une question indécidable ou factuelle. Pour Platon, la connaissance est l’effort pour discerner l’être de ce qui est, et, quand bien même il appartiendrait ainsi au logos de discerner la vérité de ce qui est, il faut encore bien du talent pour rapiécer mythiquement la réalité logique et l’être qui existe, de là ses scrupules de Pénélope qui le poussent à repriser incessamment sa théorie des Idées. Curieusement, on peut noter que l’histoire de la métaphysique a consisté à répéter un problème qu’elle avait pourtant déjà contesté dans sa pertinence, subordonnant l’existence à la vérité logique. Peut-être, au fond, ne pouvait-on se convaincre de la nullité du problème qu’en continuant de le prendre au sérieux. Si l’on nous autorisait une analogie, l’existence fut longtemps la névrose de la métaphysique ; avec Kant, la connaissance cesse de souffrir la répétition infernale de ce problème : exit la névrose de la métaphysique antique et médiévale, bienvenu dans la schizophrénie du sujet transcendantal, où la connaissance et l’existence peuvent se côtoyer indifféremment, sans que la question de leur lien soit un problème authentique pour le sujet de la connaissance. Kant, en ce sens, parachève la métaphysique ou, si l’on veut, la libère de la mauvaise foi qui la faisait encore s’égarer dans des questions ontologiques : car à quoi bon s’entêter encore à faire de l’être cette énigme qui fait face à la connaissance alors que la métaphysique s’est justement inaugurée en affirmant le primat de la connaissance sur l’existence ? La Critique de la raison pure est une métaphysique conséquente. Pour une telle pensée, « Esti » n’est pas la voie solaire qui précipite nos cavales, c’est un « fait », avec toute la platitude avec laquelle les faits s’abandonnent.
Les cavales archaïques disaient l’urgence de sortir de la Cité pour retrouver l’être dans le monde, elles disaient l’urgence de tourner le logos vers l’existence. Avec Platon s’inaugure une pensée qui ignore l’existence et qui contemple ses propres empreintes dans le sable. Comme souvent, ce sont les marges des dialogues qui le signifient avec force : voyez avec quelle réticence Socrate se laisse entraîner par Phèdre sur les chemins de la félicité naturelle, la rejetant avec une ironie condescendante dans le mythos. Penseur des murs que celui-là, pour qui il n’y a rien à voir au-delà des murs et qui méprise le chatoiement du monde. Sur le frontispice de l’Académie, il faut lire : « Qui entrera ici, jamais ne sera exposé à l’existence ».
Et tout cela ne serait que notations historiques, si cette histoire n’était la nôtre, si notre modernité ne trahissait autant notre incapacité d’être au monde. Nous avons pensé l’être, l’évidant toujours plus pour devenir nous-mêmes : des sujets.
« Esti ». « Est ! ». Qui peut encore entendre aujourd’hui l’appel de la Déesse parménidienne ? Qui peut l’entendre sans faire de l’être une fumée logique ou une ritournelle théologique ? De l’être nous ne savons plus en être. L’existence est archaïque. Et c’est en apprenant de cet archaïsme que nous retrouverons les chemins du devenir.
(25 - 01 - 2015)
Le tragique des guerres identitaires –
Sur les crimes odieux qui ont lieu ces derniers jours, je n’ai rien à écrire. Non pas que j’estime qu’on ne doive pas en avoir l’intelligence, déterminer leurs causes et délibérer sur les moyens qui interdiront la répétition et la contagion de la violence, mais cette intelligence politique de la situation appartient au sens commun, parce qu’elle engage justement un problème politique. On ne saurait, dès lors, en faire l’exercice réservé de quelques expertises ou de quelques domaines de la pensée. L’indignation est juste, nécessaire et salvatrice, mais la bêtise et la barbarie ne nous font rien penser. C’est bien trop leur accorder, en effet, que de croire qu’elles donneraient à penser, ce qui laisseraient supposer qu’elles seraient l’expression ou même le symptôme de ce qui aurait la dignité d’un problème ou d’une question légitime.
Or, si la violence fait problème, nous fait problème, c’est qu’elle est en acte la négation de toute problématicité. Aussi ne puis-je la reconnaître, comme trop de penseurs l’ont admis – sans doute pour ne jamais en avoir fait les frais – comme le moyen nécessaire d’une cause légitime, quelle que soit la cause en question. Jamais la violence ne sert la raison et, quand on ne peut l’éviter, elle ne signifie pas le triomphe de la légitimité mais au contraire son échec.
Il est clair cependant que c’est à cette nécessité de la violence que notre société est aujourd’hui confrontée, commise par la terreur à se manifester comme corps souverain dans toute sa puissance. Il est tout aussi clair que c’est là le piège que nous tend le terrorisme qui, en se prenant à des victimes innocentes (j’insiste sur ce point), cherche à nier tout principe d’innocence et produit la fiction d’un ennemi générique, identitaire, dont les victimes singulières seraient des incarnations certes accidentelles, mais non moins massacrées au nom de cette identité symbolique, pourtant si étrangère la plupart du temps à leur existence réelle. Je te tue car tu es l’Occident, tu es français, américain, chrétien ou musulman. Et quand bien même tu t’ignorais tel, voire même tu répudiais ces identités comme des illusions collectives, je te constitue par ma violence comme porteur de cette identité et déterminé par elle. Tel a été d’ailleurs le (triste, paradoxal et risible) destin réservé aux journalistes de Charlie Hebdo qui, depuis leur mort, sont devenus soudain les représentants de toutes les vertus républicaines, eux qui conchiaient symboles et oriflammes.
Si le terrorisme met ainsi fondamentalement en péril les sociétés qu’ils frappent, c’est parce qu’il n’est pas uniquement une violence barbare mais une violence qui se veut constitutive, qui veut faire la loi, contraindre la société à se reconnaître elle-même dans la figure de l’ennemi et à accepter les conditions de cette identification que lui impose cette violence arbitraire. Autrement dit, au cœur de la violence terroriste se joue le partage et la reconnaissance d’identités antagonistes, antagonisme identitaire qui est bien plus l’effet recherché par cette violence que sa cause. Qui ignore cette ambition constituante du terrorisme s’aveugle sur les buts qu’il poursuit. Car cette violence veut ériger le territoire et la division symbolique qu’elle revendique en réalités concrètes. Or, elle n’attend qu’une chose : que son identification arbitraire d’un ennemi se voit conférer, non pas tant une légitimité, mais une réalité de fait, dans la reconnaissance en retour par ceux qui sont victimes de cette violence, non seulement de sa dignité d’ennemi, mais de l’identité générique dont elle usurpe la représentation. Pour le dire simplement : que la violence terroriste soit interprétée comme une fracture identitaire et qu’elle devienne le symptôme d’un problème communautaire.
En ce sens, cette violence veut clairement doubler et imiter la puissance souveraine, en la contraignant à la régression, régression qui consisterait pour cette puissance à s’affirmer elle-même comme violence fondatrice. Le piège du terrorisme, c’est en ce sens le piège de l’imitation : imitation d’une identité usurpée, d’un idéal détourné, d’une souveraineté qu’on ne possède pas. Mais une imitation qui veut entraîner la souveraineté en-deçà de toute légitimité par la contagion de la violence, la contraindre ainsi à renouer avec une violence originaire, faisant ainsi l’aveu qu’il n’y a pas d’autre partage que la loi des uns contre les autres, instauré par le triomphe arbitraire de la force. Le terrorisme, oui, veut faire la loi, mais une loi entée sur un fantasme originel, celui d’une violence fondatrice, seule à même de donner corps à des identités. Cette loi des origines, c’est la loi sacrée, la loi de la séparation et de la soumission, d’une appartenance fondée sur l’exclusion, la loi qui s’affirme symboliquement comme le seuil de toute souveraineté et qui n’est rien d’autre que cela : un seuil, qui fonde ainsi son respect sur la reconnaissance de sa puissance de division, imposant le partage entre ceux qui seront victime de sa violence, parce qu’ils ne veulent pas entrer, et ceux qui acceptent de se soumettre à cette violence en entrant.
C’est contre cette loi sacrée que s’affirme le Droit, car si toute souveraineté s’origine dans la violence, le Droit tend à l’arracher de cette origine, en substituant à cette violence un principe de légitimité et, surtout, en substituant la relation contractuelle à la division identitaire. Et c’est pour cette raison essentielle que le terrorisme s’en prend au Droit, bien plus qu’à la souveraineté, dont il se veut l’imitation. Car le Droit, dans son principe même, introduit la variation dans les identités « naturelles », invente des rôles qui déplacent ces identités, voire les contredisent, brouille les territoires du Même et de l’Autre et, au nom d’une liberté constituante, destitue le passé et la tradition. Or, c’est cette créativité du Droit, cette capacité à faire surgir des rôles capables de subvertir les divisions identitaires, que la loi sacrée voudrait interrompre. Car si le Droit définit des rôles, ce qui sépare ces rôles de toute identité naturelle, c’est qu’ils rassemblent, là où la loi sacrée proclame la division. Le concept démocratique de citoyen en est l’expression la plus vive : un citoyen ne se définit ni par son sexe, ni par sa religion, ni par son origine, ni par sa classe sociale ; le propre du rôle politique est ainsi de transcender les divisions identitaires et de les subvertir. On est citoyen parce qu’on le devient, et ce rôle engage la possibilité d’une égalité inconditionnelle. En ce sens, c’est aussi selon leur polarisation temporelle que loi sacrée et loi politique s’opposent, car la loi sacrée institue passé et tradition (un passé antéhistorique, un passé qui nie la créativité historique dans une origine qui absorbe tout devenir) comme les marques de prestige de l’autorité, tandis que la loi politique est l’affirmation d’un à-venir toujours exigé par l’avènement des valeurs et des idéaux dont cette loi se réclame et dont l’exigence ne peut jamais être pleinement achevée.
La violence sacrée, disions-nous, imite la souveraineté pour mieux contester le Droit. Mais son imitation ne s’arrête pas là. Elle grime de même le Droit, en cherchant à le retourner contre lui-même, et cela au travers d’un usage falsifié des libertés et du respect qui leur est dû. Ainsi, au prétexte que le Droit est le garant des libertés individuelles, on le somme non seulement de garantir la liberté des cultes mais aussi le respect de leurs dogmes et de leurs rites. Et si le législateur refuse de faire le pas de la défense des libertés à ce respect, on accuse le Droit de trahir le principe d’universalité qu’il est censé incarner pour n’être que le masque d’une « idéologie », la laïcité ; laïcité qui reviendrait à imposer une vision du monde et un habitus culturel sous couvert d’une exigence de liberté. Autrement dit, on attend que la liberté des cultes soit interprétée comme la reconnaissance de leur sacralité, que le Droit rétrocède aux religions la possibilité de faire la loi et de convertir ainsi cette liberté en devoirs pour tous les autres, pour tous ceux qui sont étrangers à leur foi et à leur culte. Or, si en la matière la loi garantit à chacun la liberté de pratiquer sa foi, elle n’impose aucunement le devoir pour tout autre citoyen de se soumettre aux exigences de ce culte et à ces rites sacrés. Ce glissement de la liberté de pratiquer un culte au respect dû à ses dogmes par la société entière est remarquable dans les sociétés anglo-saxonnes. Or, comment ne pas voir qu’un tel respect prescrit au nom de la liberté des cultes est incompatible avec un principe de pluralisme et de coexistence des libertés ?
Dans La politique de reconnaissance (1992), Charles Taylor soutient la nécessité de sortir d’une politique égalitaire qui confine à une forme d’ « aveuglement aux différences » et qui consiste à dénier la reconnaissance des identités culturelles. Ainsi, tel qu’il le souligne, « de même que tous doivent avoir l’égalité des droits civiques et du droit de vote, sans considération de race ni de culture, de même tous devraient bénéficier de la présomption que leur culture traditionnelle a une valeur ». Cette variante « hospitalière » du libéralisme, toutefois, dans laquelle « l’intégrité des cultures a une place importante », « doit [pourtant] savoir où s’arrêter » selon lui. Ainsi, « il y aura des variantes pour l’application des codes de droits, mais pas là où l’on incite à l’assassinat ». Se rapportant à l’arrêt de mort dont fut menacé l’écrivain Salman Rushdie, Taylor relève que « dans ces circonstances, il y a quelque chose de maladroit à répondre simplement : « Ici, c’est comme ça ! ». Il faut pourtant faire cette réponse dans des cas comme l’affaire Rushdie, où le « c’est comme ça » recouvre des questions comme le droit de vivre et de parler librement ». Et Taylor de conclure : « La maladresse naît du fait qu’il y a bon nombre de gens qui sont citoyens tout en appartenant à la culture qui remet en question notre territoire philosophique. La difficulté est de concilier leur sens de la marginalisation sans compromettre nos principes politiques de base ». L’embarras de Taylor est remarquable, lui qui soutient pourtant – et nous sommes tout prêt à le suivre sur ce point – la juste reconnaissance des cultures au sein de démocraties suffisamment matures pour conjoindre un principe d’égalité et de reconnaissances des identités plurielles qui la constituent. Toutefois, peut-on vraiment dire qu’en raison du passé colonial violent des sociétés libérales elles-mêmes, « la réponse « Ici, c’est comme ça » peut paraître rude et dénuée de délicatesse » ? Je ne suis pas sûr que la juste (et mauvaise) conscience que les démocraties modernes doivent avoir de leur responsabilité historique puisse jeter un discrédit sur leur volonté de défendre les libertés individuelles de tous leurs membres et la possibilité pour chacun de vivre sans être menacé par les autres. Mais ne pouvant (ne voulant) affronter ce problème, Taylor le contourne par la grâce d’une formule sibylline : « l’exigence [est] de laisser les cultures se défendre elles-mêmes, dans des limites raisonnables ». Or, ce faisant, Taylor évacue de sa réflexion la possibilité, pourtant ô combien problématique, que le conflit qui oppose libéralisme et multiculturalisme ne provienne pas uniquement d’une conception autoritaire de l’égalité par le libéralisme lui-même mais du rejet par une « culture » des principes qui animent les démocraties libérales, un rejet qui ne serait pas simplement une réaction à la violence que le libéralisme fait subir à ces identités en ne leur accordant pas une juste reconnaissance, mais qui procéderait de cette « culture » même, celle-ci cristallisant l’identité dont elle se réclame sur le rejet des valeurs de l’Occident. Je voudrais que l’on prenne bien garde aux guillemets dont j’ai accompagné le mot de culture, suivant en cela la réflexion de Charles Taylor. Car son propre embarras tient justement à l’indéfinition dans laquelle il maintient ce concept tout au long de sa réflexion, ce qui le conduit selon moi à ne pouvoir faire la part entre la juste reconnaissance des cultures et des affirmations identitaires fondées sur la violence, violence qu’il interprète trop vite comme une réaction au libéralisme. Je ne prétends pas ici palier suffisamment ce flou conceptuel autour de la culture, seulement pointer la limite où une revendication identitaire usurpe ce principe de reconnaissance culturelle pour se prévaloir du droit de faire la loi. Ainsi, quand sous le nom de culture on veut imposer à d’autres ses règles et ses dogmes, il ne s’agit plus de culture mais de politique, et cette politique ne se distingue guère par sa violence arbitraire des formes anciennes de l’impérialisme. En ce sens, si Taylor est embarrassé et juge maladroit qu’une démocratie, qui demeurerait fidèle à une politique de reconnaissance des identités plurielles, soit condamnée à décréter « Ici, c’est comme ça ! », il omet de dire (ou de penser) que cette déclaration souveraine n’est jamais que le refus légitime de la violence des uns sur les autres sous prétexte du respect de leur identité. Autrement dit, ce « Ici, c’est comme ça ! », qui fait selon Taylor du libéralisme qu’il le veuille ou non « un credo de combat », ne s’entend que comme la réponse à toute politique identitaire qui voudrait que cet « Ici, c’est comme ça ! » soit la marque du respect qui lui est due. Oui, une démocratie libérale peut affirmer : « Ici, c’est comme ça ! » sans trahir ses principes, sans que ce soit un lapsus de son impérialisme toujours latent, car cette proclamation ne recèle rien d’autre qu’une affirmation de liberté commune et partagée. « Ici, c’est comme ça ! » doit s’entendre alors comme suit : Ici, nul ne peut dire aux autres « Ici, c’est comme ça ! » et leur imposer ses règles, ses rites, ses coutumes et sa foi. Aussi le libéralisme politique n’est aucunement un « credo de combat », comme l’affirme Taylor, mais tout le contraire : il est le refus de tout « credo », car la foi est une affaire privée, et le refus redoublé que l’on puisse faire d’un « credo » le nom d’un « combat » que l’on imposerait à ceux qui ne le partagent pas.
Voilà – je dois le souligner – à quel degré de platitude nous condamne le surgissement d’une violence barbare : à rappeler des évidences. Mais c’est justement ce que la barbarie terroriste voudrait nous faire perdre, le sens de nos évidences, des évidences les plus nobles et les plus justes : celles qui animent l’esprit démocratique de sociétés où soit préservée la possibilité d’une vie en commun sous le signe d’une liberté partagée, où chacun puisse ainsi être ce qu’il est, penser et s’exprimer librement, sans appeler à la violence ni subir la violence des autres.
C’est un tel pacte démocratique dont John Rawls rappelle les principes évidents dans Justice et démocratie. Quel est donc le but du pacte démocratique ? Il ne s’agit pas de « prendre parti », de soutenir un idéal parmi d’autres (une « doctrine compréhensive » de l’existence humaine, selon l’expression de Rawls) mais de faire qu’elle puisse coexister, selon des conditions qui soient tolérables pour toutes. Autrement dit, le but du politique n’est pas de se prononcer sur la vérité ou la fausseté de ces doctrines religieuses ou métaphysiques. La vérité morale n’est pas la question que se pose la politique ; son rôle est d’empêcher que les membres d’une société ne se fasse subir la violence arbitrairement les uns les autres. Le législateur ne se prononce sur les fins dernières de l’existence : il ne cherche qu’à permettre la vie en commun. Partant, s’il peut être amené à exercer une contrainte sur les adeptes d’une doctrine quelconque qui exercent une violence sur les autres membres de la société, ce n’est pas au nom de la vérité, mais uniquement parce que la violence n’est aucunement acceptable, quels que soient la raison ou l’intérêt qui la motivent. En ce sens, si une société démocratique est une société qui se fonde sur un pacte de liberté qui permet le conflit des doctrines, elle se doit de donner, comme seule limite à cet affrontement, que le principe qui l’a rendu possible ne soit pas menacé. Cette limite n’est pas une façon de faire choix d’un sens de la vie humaine, mais tout simplement de rendre possible la vie partagée. Puisque, par ailleurs, il n’y a pas d’extériorité de la société politique (puisque nous ne serions vivre en dehors d’une vie commune), une doctrine, qui récuse ce pacte de raison commune, ignore que ce pacte, seul, lui garantit une expression libre.
Partant, la démocratie, en son principe, ne se substitue pas aux diverses religions, ni ne rivalise avec elles ; la démocratie n’est pas une « religion » qui ne dirait pas son nom ; elle n’implique qu’une « foi », celle de la liberté, la liberté qui permet seule la diversité des expressions et des opinions. Aussi irréductible et adverse que soient les conceptions doctrinales et morales de l’existence humaine, elle les préserve. En ce sens, peut-on dire que la démocratie marque la fin des religions ? Non. Elle permet au contraire leur expression, selon un pacte de raison et de tolérance mutuelle.
(03-05-2015)
Le grand renfermement platonicien (2) – Œdipe et Socrate face à l’oracle.
Métaphysique : science de l’Etre en tant qu’Etre. Seul Parménide a anticipé le sens secret d’un tel redoublement qui ne pouvait que consister à opposer l’Etre à l’Etre, à loger le non-Etre dans l’Etre en faisant du non-Etre la vérité de l’Etre. Platon, plus qu’Aristote, est le père de cette histoire de l’Etre, ou plus exactement : de cette histoire du non-Etre qu’est la métaphysique, un Etre qui, dès l’origine de la science qui le prit pour objet, était déjà une fumée, s’éventant au creux d’une parole qui prétendrait le recueillir. Toute la geste de l’histoire de la philosophie a consisté ainsi à ériger une vérité de l’Etre sur le fond de sa négation, la négation de l’existence du monde, figurée comme le tour de force d’une pensée subtile, quand elle ne fut rien d’autre que l’aveu de notre incapacité à être au monde. Du non-Etre nous avons fait notre substance : je pense donc je suis. Et de même que le Robinson du roman de Patrick Chamoiseau, L’empreinte à Crusoé, nous ne voyons plus du monde que notre empreinte dans le sable, le creux de notre absence, le fétichisme de notre parole, de la parole qui parle, si chère à Heidegger.
Renfermement de l’Etre dans le logos mais aussi, conjointement, inséparablement, renfermement de l’homme dans la Cité. C’est l’autre aspect de l’héritage platonicien. Platon a inventé l’homme social, l’homme comme genre et comme unité de ce genre, d’un Tout qui détermine ses parties et en distribue les attributs. Mais il fallait encore, pour que cette invention soit possible, commencer par vider la scène tragique, le spectacle d’une vérité énigmatique qui échapperait à la raison, d’un homme que son destin et sa vérité entraînerait hors les murs. Car le tragique nous renvoie à la condition d’un homme errant, qui jamais ne peut se rendre maître de sa propre vérité, dont la vérité se tient hors de son savoir, hors de son pouvoir, accusant l’ignorance et l’impuissance qui les doublent fatalement.
La force des mythes tragiques tient tout entière dans la façon dont ils tendent un miroir à notre histoire, non parce qu’ils recéleraient une vérité universelle dans laquelle la conscience d’une époque pourrait trouver refuge en la tirant de l’oubli, mais plutôt du fait de leur irrésolution – du moins est-ce le terme qui me semble le plus juste. S’il y a un sens en effet à parler d’une vérité irrésolue des mythes, c’est dans la mesure où jamais leur vérité ne peut être rassemblée en un jugement, ni leur signification donner lieu à des lois. La critique platonicienne des mythes, et tout spécialement des mythes tragiques, a pour motivation essentielle cette ambiguïté des mythes qui se refuse à la logique conclusive du jugement, à la possibilité de commuer la vérité en lois et de la rendre entièrement prononçable.
En devenant philosophème, la vérité cesse d’être cette puissance dans laquelle la pensée trouve son élan et puise ses figures, tout en étant toujours renvoyée à son incomplétude, son incapacité à épuiser cette présence têtue dans et par le discours. Car en faisant le procès de la tragédie, dans la République, Platon veut avant tout rompre avec la conception archaïque de la vérité, celle d’une vérité qui se tient en dehors du logos et ne s’y laisse point résoudre, d’une vérité qui résiste à la raison législatrice. Nombre de commentateurs ont insisté sur le caractère essentiel du rejet du discours tragique par Platon mais cette exclusion détermine sans doute de part en part sa pensée et cela pour des raisons qui dépassent la simple condamnation du régime passionnel des tragédies. Pour donner place, en effet, à un nouvel ordre de vérité, une vérité qui soit propre au logos et à sa législation, Platon entreprend, sous le nom de dialectique, une déconstruction systématique du régime tragique de la vérité et, par elle, de la vérité archaïque. L’exposé qui suit ne prétend pas en épuiser toutes les formes mais en apporter les indices probants.
On ne peut mieux énoncer le sens de cette vérité archaïque qu’en disant qu’elle est énigmatique – et par-là même éminemment poétique et tragique. Parce que nous sommes les héritiers de la philosophie, c’est-à-dire de la réduction platonicienne de la vérité au jugement, une « vérité énigmatique » est pour nous soit un non-sens soit un mystère religieux. Est « énigme » pour la pensée archaïque la parole où se mêle la clarté et l’opacité, d’une façon si inextricable que l’une ne se déploie qu’en figurant l’autre, que le déchiffreur s’aveugle quand il croit voir (Œdipe) et voit parce qu’il est aveugle (Tirésias). Comme l’a remarquablement montré Jean-Pierre Vernant dans son analyse de l’Œdipe-Roi, l’énigme condense toute la vérité tragique, vérité de l’ambiguïté, où toutes les valeurs, les paroles et les rôles sont commis à une duplicité qui les entraîne à se retourner contre eux-mêmes et à échanger leurs attributs ; la vision tragique est celle d’ « un monde divisé contre lui-même, déchiré par les contradictions », et telle que cette duplicité énigmatique se rassemble dans l’énigme qu’est Œdipe lui-même, lui qui « sans qu’il le sache, sans l’avoir voulu ni mérité (…) révèle, dans toutes ses dimension sociale, religieuse, humaine, inverse de ce qu’il paraît à la tête de la cité » : « L’étranger corinthien est en réalité natif de Thèbes ; le déchiffreur d’énigmes, une énigme qu’il ne peut déchiffrer ; le justicier, un criminel ; le clairvoyant, un aveugle ; le sauveur de la ville, sa perdition ».[1]
Comme le souligne Vernant, cette vérité énigmatique, qui est celle de l’énigme de la vérité, de toute vérité, qui renvoie ainsi tout savoir à sa duplicité, tout logos à l’inouï qu’il recèle, toute vision à la nuit qui l’environne et dont elle procède, féconde une conscience tragique : « A travers ce schème logique de l’inversion, correspondant au mode de penser ambigu propre à la tragédie, un enseignement d’un type particulier est proposé aux spectateurs : l’homme n’est pas un être qu’on puisse décrire ou définir ; il est un problème, une énigme dont on n’a jamais fini de déchiffrer les doubles sens ».[2] Or, c’est bien cette énigme qu’il s’agit pour Platon de lever : l’énigme d’une vérité qui se tiendrait hors du logos et le doublerait, accusant sa cécité, l’énigme d’un homme qu’on ne pourrait déchiffrer entièrement, que les lois ne pourraient pleinement définir et qui leur opposerait toujours un destin inqualifiable, l’idée que se tiendrait hors les murs un Etre et une question irrésolus.
La dialectique doit être comprise comme une méthode de réduction des ambiguïtés, une « machine » (si l’on me passe ce concept deleuzien) à distinguer, diviser, hiérarchiser des valeurs, qui sont tenues de s’articuler sans se mêler ni se confondre, selon un ordre immuable, qu’il soit logique ou politique. S’il y a quelque chose comme un « projet » platonicien, c’est celui-ci : en finir avec l’énigme, la confusion et la transgression des ordres qui caractérise la pensée archaïque et tragique, afin de fonder un ordre qui conjoigne de façon pleinement opératoire le savoir et les pouvoirs[3], la vérité et l’action.
Comme le note Vernant, « le monde tragique ne comporte pas de philosophes aptes à classer les êtres dans leur hiérarchie véritable, et c’est du reste pourquoi Platon rejette la tragédie (…) Le monde tragique exclut la hiérarchie des savoirs et l’union du savoir et du pouvoir que le philosophe entendra réaliser. Pouvoirs et savoirs s’affrontent dans cet opaque qui sépare le monde des dieux de celui des hommes ».[4]
Les dialogues platoniciens sont ainsi une entreprise de déconstruction du monde et de la conscience tragiques : il est non seulement possible de résoudre toutes les énigmes mais, plus encore, de les vider de leur pouvoir de confusion, en montrant que ce qui troublait la pensée et désarçonnait le jugement n’était rien d’autre que le jeu de l’être et des apparences dont la logique peut venir à bout. Il n’y a pas d’énigmes mais de simples illusions : et si le faux peut se faire passer pour vrai, toute confusion ou ressemblance n’est jamais ontologique mais se résout en un jeu de dupes qui ne doit pas leurrer le dialecticien. Il faut donc refuser de donner à la contradiction un sens ontologique qui la rendrait irréductible. La pensée platonicienne ne connaît ainsi aucune contradiction véritable, que des contradictions apparentes ; c’est une pensée de la distinction, non des ressemblances, une pensée de la ligne, non du cercle, le cercle (forme symbolique la plus expressive de la pensée archaïque) où chaque chose se renverse sur elle-même, où le Même et l’Autre ne sont jamais assurés dans leur division. Platon est le premier penseur de l’identité et de la différence. Or, c’est un tel partage qu’interdit et menace l’énigme tragique. Ainsi, le traitement allégorique que Platon réserve aux mythes est une façon de montrer qu’il n’existe pas d’énigme indéchiffrable, que toutes ont leur clé logique, que les contradictions qui troublent la pensée ne lui sont jamais étrangères, mais procèdent d’un jeu logique et trouveront dans ce jeu même l’occasion de leur dépassement. Pas d’énigmes donc, que des problèmes. On peut légitimement en ce sens définir la philosophie comme l’apparition d’une herméneutique nouvelle ayant comme but premier de mettre un terme à la vérité et à la conscience tragiques.
L’un des enjeux, sans doute inaperçu, de la fameuse défense de Socrate face à ses juges athéniens dans L’apologie, est de déjouer le « piège » tragique qu’enveloppent les énigmes oraculaires. Il s’agit en effet tout autant pour Platon d’exposer la méthode dialectique que de lui donner droit contre toute ambiguïté tragique. La façon dont Socrate résout ainsi l’énigme oraculaire est un tour de force où la dialectique déclare sa possibilité avec génie et, par bien des aspects, assèche la puissance énigmatique de tout oracle. En ce sens, il n’est pas impossible – ainsi que nous allons le tenter, d’interpréter cette défense comme l’exacte réponse à l’illusion tragique à laquelle succombe Œdipe face à l’oracle : le sens de la dialectique se mesure ainsi à la façon dont elle nous émancipe de l’aporie tragique à laquelle l’ambiguïté oraculaire condamne la pensée.
Ressaisissons brièvement la façon dont Socrate déjoue l’énigme (Apologie de Socrate, 20d-21e). Kairéphon rapporte à Socrate l’étonnante réponse de l’oracle divin à sa question : existe-t-il quelqu’un de plus savant que Socrate ? La réponse du dieu est qu’il n’en existe pas. Non moins que les oracles tragiques, cette réponse déconcerte le dialecticien, le condamnant à l’aporie, ce qui est l’un des effets remarquables des énigmes. Car, si le dieu attribue à Socrate le savoir le plus parfait, lui-même quand il s’interroge a le sentiment de ne l’être en aucune façon. L’aporie est donc la suivante : soit Socrate se ment à lui-même, soit il fait mentir le dieu, mais comment le dieu pourrait-il mentir ? Notons que cette situation du penseur face à l’oracle est cela même qui donne corps le plus ordinairement à la conscience tragique : l’oracle annonce une vérité qui contredit la conscience et que celle-ci refuse. Il n’y aurait pas aucun tragique si celui qui reçoit la vérité oraculaire pouvait l’accepter et s’y reconnaître. C’est bien cette impossibilité de se reconnaître dans les énigmes qu’on lui oppose qui, comme le montre Jean-Pierre Vernant, fait d’Œdipe lui-même une énigme, cette énigme qu’il est, qu’il ne peut élucider, par laquelle il sera au contraire élucidé, au plus loin des vérités dont il se croyait le déchiffreur et que son enquête poursuivait.
Or, il faut souligner une différence de taille dans les façons dont Socrate et Œdipe reçoivent l’énigme et cette différence a une portée proprement historique : Œdipe[5] pourrait très bien, comme le fait Socrate, confronter et soumettre la parole de l’oracle à son sentiment et à son jugement. De même que Socrate évalue la parole de l’oracle au gré du sentiment qu’il a de lui-même, il pourrait ainsi se demander si la révélation oraculaire est ou non conforme à ce qu’il sait de lui-même ; par exemple, si ce destin que l’oracle lui annonce peut trouver sa confirmation dans un quelconque désir qu’il aurait effectivement de tuer son père et d’épouser sa mère. Or, c’est justement cette conscience et ce jugement qui font défaut à Œdipe et cette absence de l’un et de l’autre qui le constitue comme « sujet tragique », c’est-à-dire comme sujet à la tragédie : celui qui ne possède pas sa propre vérité. Et c’est à l’inverse cette conscience et ce jugement qui sont la pierre d’achoppement de la réduction dialectique de l’énigme oraculaire, car seul celui qui, comme Socrate, affirme contre l’oracle sa vérité, celle de son jugement et de son être à soi, peut convertir cette énigme en un problème à résoudre.
Ici, nous n’hésiterons pas à qualifier Socrate de premier sujet de l’histoire de la pensée car, quel que soit ce qui le sépare encore de la subjectivité à venir, il en est le héraut. La confrontation avec Œdipe peut donner la portée de l’audace socratique face à ses juges ; car que dit-il en somme si l’on y prend garde ? Je m’appartiens et quelque vérité que je puisse reconnaître aux oracles, leur sens aura pour unique étalon mon jugement et la vérité que je possède sur moi-même. Je sais qui je suis et ce savoir, ni les hommes ni les dieux ne peuvent me le contester : voilà une idée qui jamais ne pourrait venir à Œdipe, puisque il n’y a de « sujet » tragique que sur l’horizon de cette impossibilité d’être ce que l’on est et de le confirmer dans la conscience que l’on a de soi. La conscience tragique se signifie par cette doublure que produit l’énigme oraculaire dans tout discours sur soi : est tragique la situation qui accuse l’impossibilité pour un tel discours de se prémunir de l’illusion et de garantir sa propre authenticité. Œdipe est condamné à croire qu’il est ce qu’il est ; et le double sens de son nom lui-même dit cette vérité impossible sur soi, cette conscience condamnée à l’usurpation, condamnée à être rattrapée par la vérité d’un destin qui hante la conscience et souille toutes ses certitudes : Œdipe, celui qui sait, celui qui boîte ; tout savoir est une boiterie, et toute conscience est boiteuse, boiteuse non pas en dépit de ce savoir mais par ce savoir lui-même, ainsi que le signifie son ignorance tragique face à la Sphinge, lui qui ne peut jamais toucher à la vérité qu’au prix de son aveuglement, qui résout l’énigme et, dans le même temps, ne l’entend pas, qui ne trouve « l’homme » qu’en perdant l’homme qu’il est, cet homme-là sur le chemin duquel, pourtant, l’énigme de la Sphinge le conduisait, comme le montre brillamment Jean-Pierre Vernant. Car cette ambiguïté est constitutive de ce que l’on peut nommer l’ignorance tragique : pour Œdipe, tout savoir se double d’une ignorance, toute lucidité d’un aveuglement, toute énigme résolue approfondit l’énigme, la redouble. Quand bien même l’illusion tragique serait levée, elle ne peut jamais toutefois être résolue car il faudrait pour cela que le savoir et l’action puisse se rejoindre et être conjoints. Or, c’est cela même qui est refusé au héros tragique : Œdipe ne peut savoir et pouvoir dans le même temps, il ne le peut que tour à tour, et telle que l’une de ses possibilités occulte l’autre ; il est en effet le tyran ignorant ou bien le savant impuissant ; la tragédie est tragédie des inconciliables, qui se renversent l’un dans l’autre quand ils devraient se repousser, qui se repoussent quand ils devraient s’allier. Et si l’énigme tragique n’est ainsi jamais résolue, c’est dans la mesure où elle ne pourrait trouver sa résolution que dans la conjonction du savoir et de l’action. Le sujet moderne est au contraire déjà annoncé toutes les fois où le hiatus entre le savoir et l’action devient inopérant ; inversement, notre subjectivité chavire et trahit sa propre fiction quand cette contradiction reprend vie.
Comment donc devenir un déchiffreur d’énigmes sans être le jouet du piège tragique que tend la vérité énigmatique à tout savoir, condamné par elle à aveugler autant qu’à révéler ? Si la vérité tragique se livre dans l’éclatement et la dispersion selon une pluralité de voix qui ne peut pas être subsumée dans un discours unifié, il faut, pour en finir avec cette vérité irrésolue, attribuer au savoir un sujet, un et unique, un sujet qui puisse par son jugement devenir la norme de la vérité et opposer aux énigmes la certitude de son être à soi.
Socrate est le nom de cette invention : un savoir de soi-même capable de se substituer aux vérités anciennes. En effet, rapportée à la certitude du jugement, la vérité oraculaire, aussi aporétique qu’elle puisse apparaître, n’est plus une énigme indépassable, car elle ne peut entrer en conflit avec le savoir que le sujet a de lui-même, savoir que l’énigme peut certes étonner ou retarder, mais qu’elle ne peut déjouer. « Que peut bien vouloir dire la réponse du dieu, et quel en est le sens caché ? » (21b) Pour poser, comme le fait Socrate, cette question en retour à l’oracle, il faut encore qu’il y ait la certitude d’être ce que l’on est, de savoir ce que l’on sait, ce sans quoi l’énigme ne pourrait être interrogée dans son « sens caché », disposée ainsi, déjà, à être interprétée, mais renverrait au contraire celui qui la reçoit à sa propre opacité. Car – et c’est ce qui fait d’Œdipe la figure tragique par excellence, il n’y a d’énigmes véritables que celles qui vous constituent vous-même comme une énigme. Or, c’est ce contrat tragique de l’oracle que refuse justement Socrate : il refuse d’être déchiffré par l’énigme, lui qui lui oppose la vérité de ce qu’il se sait être à cette énigme (« Que peut bien vouloir dire la réponse du dieu, et quel est en est le sens caché ? Car j’ai bien conscience, moi, de n’être savant ni peu ni prou. »). Partant, la vérité que déclare l’oracle peut désormais s’entendre au figuré car il n’existe qu’une vérité propre, celle de notre être à soi que déclare le jugement, critère de vérité qui ne saurait être détrompé et auquel, quel que soit le chemin poursuivi, nous serons nécessairement reconduits. Ce n’est donc plus en soi-même qu’il faut rechercher la déformation réglée du vrai mais dans les apparences, qu’il s’agisse des apparences sensibles ou du sens apparent des manifestations divines. Si l’illusion tragique se déclare au cœur de l’identité, de ses faux-semblants, et de la duplicité de toute parole, Platon au contraire loge l’illusion hors du jugement, dans le monde phénoménal, monde où est reversé le jeu de l’Etre et de l’apparence qui, dans la tragédie, n’épargne pas l’intelligence et la concerne au premier chef. Il fallait inventer un déchiffreur d’énigmes qui ne soit pas emporté lui-même par le vertige de l’herméneutique et qui puisse abruptement, presque grossièrement, interrompre le jeu subtil de la vérité énigmatique en lui rétorquant cette sentence : moi, je me connais et le dieu ne saurait m’apprendre sur moi-même quelque chose que je ne sache pas.
En 362 avant JC, la Pythie de Delphes rendait son ultime oracle à l’émissaire de l’empereur Julien : « Allez dire au roi que le bel édifice est à terre, Apollon n’a plus de cabane ni de laurier prophétique, la source est tarie et l’eau qui parlait s’est tue ». Bien avant cette date, la philosophie se signifiait comme la volonté de renverser le bel édifice et de tarir la source. Une seule bouche de la vérité : notre jugement souverain.
Conscience dialectique et tragique se font donc bien pendants face à l’oracle. Œdipe, le « déchiffreur d’énigmes », est bien plus déchiffré par les énigmes qu’il ne les déchiffre (s’il résout l’énigme de la Sphinge, il ne la déchiffre pas et passe à côté de son sens véritable) parce qu’il n’y a aucune norme du jugement qu’il puisse opposer à cette vérité. Dès lors, le « sens caché » de l’énigme ne saurait être recherché dans l’énigme elle-même ; pour les tragiques, la puissance herméneutique est du côté de la vérité tragique, non pas de celui qui l’affronte : le « sens caché » de l’oracle, c’est l’Etre d’Œdipe lui-même. Tout au contraire, le jeu et la duplicité sont rejetés par Socrate du côté de l’énigme, non du sujet du savoir ; c’est bien là le tour de force de la dialectique : elle consiste à s’emparer contre la conscience tragique de la puissance herméneutique. Il est là le « vrai » déchiffreur d’énigmes : Socrate, qui déchiffre la vérité en refusant d’être déchiffré par elle. Mais cette puissance arrachée à la vérité tragique à son revers – revers qui, encore une fois, nous parle de notre histoire : car celui qui devient le déchiffreur de la vérité interdit de facto la possibilité que l’énigme de son être, l’énigme qu’il est, lui soit un jour levée. Œdipe se crève les yeux à sa propre vérité, mais il est un moyen d’échapper au tragique : en constituant le savoir de soi-même sur la certitude de notre jugement, certitude qui confine à une ignorance, cette ignorance délibérée qui consiste à refuser d’être la question. Tel est le contrat dialectique, car il fallait bien abandonner quelque chose pour devenir le déchiffreur souverain de toute vérité : il fallait renoncer à trouver une vérité sur soi-même et le meilleur moyen pour ne pas la trouver était encore de postuler qu’elle n’était pas à rechercher, que cette vérité, nous la possédions de fait, dans la certitude de notre jugement. Le sujet du savoir ne devient pas transcendantal par la grâce de Kant, il l’est dès l’avènement de la vérité philosophique. Socrate, pour être le déchiffreur de toutes énigmes, est condamné à être lui-même et à ne jamais devenir ce qu’il est, c’est-à-dire à être l’autre qu’il est, à avoir autrement dit une histoire, puisqu’il est celui qui se sait lui-même. Œdipe erre, tout à la fois en fuyant et en recherchant ce qu’il est, mais il se trouve au bout du chemin. Le sujet du savoir qu’invente Socrate, lui, échappe certes au destin mais il ne le peut qu’au sacrifice de tout devenir, de toute histoire. Il n’y a rien au bout du chemin, parce qu’il n’y a pas de chemin vers soi. Un sujet nous est advenu. La Krisis n’est pas moderne : elle s’inaugure avec la philosophie, quand les oracles parlent au figuré. Sans doute – et il a fallu longtemps pour le comprendre ; l’avons-nous vraiment compris ? – cette exténuation de l’énigme tragique mettait un terme à l’irrésolution de tout savoir, mais n’ouvrait-elle pas sur une autre errance, plus profondément, plus secrètement tragique que celle de la tragédie antique ? L’errance d’un sujet sans histoire, condamné à dire sa propre béance, non pas, comme Œdipe, condamné à se reconnaître, à trouver au terme de son enquête ce qu’il ignorait bien plus encore qu’il ne le fuyait, mais à ne jamais trouver que lui-même, son ipséité vide, toujours déjà possédée dans la certitude de son jugement. La philosophie, c’est la fin du suspense. Et ce n’est pas rien.
Cependant, il ne suffit pas encore d’affirmer le primat du jugement en matière de vérité pour échapper au piège de l’énigme oraculaire. Il faut rompre le cercle du savoir et de l’ignorance, d’un savoir qui est toujours susceptible de se renverser en ignorance et faire ainsi que la reconnaissance de la vérité procède du sujet lui-même et ne soit pas ce qui lui advient malgré lui, le surprend et lui révèle l’inanité de son savoir, comme c’est le cas dans l’expérience tragique de la vérité. Le génie de Socrate face à ses juges consiste justement à retourner le processus de la reconnaissance tragique contre lui-même dans l’interprétation qu’il propose de la vérité oraculaire. Si la vérité tragique, dont Œdipe est dupe, consiste à renverser le savoir en ignorance, la dialectique socratique, elle, renverse l’ignorance en savoir, déjouant ainsi le piège tragique. C’est là la célèbre élucidation de l’énigme oraculaire que propose Socrate : je suis en effet plus savant que l’homme qui croit l’être, moi qui affirme mon ignorance car « en effet, il est à craindre que nous ne sachions ni l’un ni l’autre rien qui vaille la peine, mais tandis que, lui, il s’imagine qu’il sait quelque chose alors qu’il ne sait rien, moi qui effectivement ne sais rien, je ne vais pas m’imaginer que je sais quelque chose » (21d). La ruse est habile et fait de Socrate ce qu’il a sans doute toujours été : un grand sophiste. Car, en effet, quelle meilleure façon d’interrompre le jeu ambigu du savoir et de l’ignorance qu’en absorbant l’ignorance, en en faisant la condition même du savoir ? En se sachant ignorant, on n’a pas à craindre de voir soudain, dans un moment de reconnaissance tragique, son savoir se révéler en son ignorance même ; en absorbant la contradiction, on ne risque pas d’être victime du jeu ambigu des termes contradictoires. Le coup de force socratique est de désamorcer ainsi l’ambiguïté tragique en retournant le discours double et la logique des contradictions qui anime la vérité oraculaire contre elle-même. Il n’y a plus dès lors antinomie entre le savoir parfait que l’oracle reconnaît à Socrate et l’ignorance que celui-ci s’attribue, plus de risque que la vérité tragique ne confonde Socrate et renverse ses certitudes en illusions. Car comment détromper de son savoir celui qui se sait ignorant ? Qui se sait ignorant n’a pas à craindre de devenir ce qu’il ne se savait pas être. De l’affirmation du jugement comme norme de vérité à la reconnaissance de cette ignorance, le renversement de la vérité tragique est donc complet : si Œdipe est celui qui sait mais qui s’ignore lui-même et n’atteint à une vérité sur lui-même que dans l’aveuglement, Socrate est celui qui se sait lui-même, qui fait de son jugement la norme de la vérité mais d’une vérité qui se veut la conscience de son ignorance, détrompant ainsi le processus de la reconnaissance tragique en faisant du renversement du savoir en ignorance la vérité même de son jugement.
La ruse est certes belle mais il y a dans ce dépassement logique de la reconnaissance tragique par la dialectique, quelque chose qui ressemble à la « causa sui » des théologiens. Car, somme toute, Socrate triomphe-t-il vraiment de l’énigme oraculaire ? En maîtrise-t-il tant le « sens caché », comme il le prétend ? Sa résolution de l’énigme ne dépasse pas, comme il le croit, l’ambiguïté tragique mais au contraire en confirme la vérité, une vérité dont il ne pressent pas, comme les héros tragiques, qu’elle renversera ce qu’il croyait être et savoir. Car, n’est-il pas en effet l’homme le plus savant qui soit, lui qui se sait ignorant, et qui ignore d’autant plus qu’il est savant, le plus savant de tous, qu’il croit pouvoir faire de son ignorance une disposition à la vérité ?
Qui croit savoir en effet ? Est-ce vraiment ce potentat auquel Socrate rend visite et qui se complaît dans sa savante ignorance, ou bien Socrate lui-même qui prétend échapper souverainement au piège de la reconnaissance tragique en s’emparant de la contradiction qui le menace. Il n’y a pas, en ce sens, de savoir plus ignorant de sa propre ignorance que celui qui prétend faire de son ignorance un savoir. Ce que méconnaît ici Socrate, et ce qui singulièrement le fait ressembler, malgré lui, à Œdipe, c’est que le piège de l’énigme ne se renferme jamais sur vous avec autant d’efficacité que lorsque l’on croit possible de lui échapper. On ne lui échappe pas en fuyant, comme le fait Œdipe ; on ne lui échappe pas non plus en croyant s’emparer de sa contradiction, comme le fait Socrate. L’un et l’autre s’exposent tragiquement à l’oracle car ils croient possible d’en conjurer la vérité. Seulement, le tragique de l’histoire de la vérité qu’ouvre la pensée socratique est un tragique sans tragédie, un tragique qui n’advient pas à la conscience de lui-même dans ce regard des hommes sur eux-mêmes qu’ouvrait la scène tragique et par lequel les Grecs ont su s’exposer à l’énigme du destin humain. La tragédie était, selon le mot de Sophocle, ce moment inédit où l’homme s’affronte et se reconnaît, se figure en sa propre énigme qui le fait être, selon une ambiguïté que rien ne peut résoudre, à la fois un monstre et une merveille. Or, le sujet du savoir échappe à son propre regard. L’homme n’a plus à faire face à son propre aveuglement, se voir aveuglé et se reconnaître tel qu’en lui-même, ce monstre et cette merveille. Car la conscience tragique consiste en ces renversements du regard qui met le voyant en face de sa propre cécité. C’est cette connaissance de soi, proprement tragique, que Platon nie dans sa possibilité : nulle vision ne peut être la vision d’elle-même, nous prévient Socrate dans le Charmide. Et nul ne saurait, somme toute, lui donner tort, car il faut risquer de se crever les yeux pour se voir ainsi. La vérité du sujet du savoir suppose au contraire un regard invisible à lui-même, invisible à sa propre nuit. Spéculaires, tous nos savoirs se sont fondés sur cette vision simple, dépouillée de toute énigme, où l’aveuglement sur soi-même devenait la condition paradoxale d’une connaissance panoptique. Or, c’est sur le fond d’une concession au tragique que notre conscience a pu ainsi affirmer sa souveraineté. Héritiers de Socrate, nous n’en demeurons pas moins semblables à Œdipe : nos yeux sont crevés. Avec cette différence : Œdipe se crève les yeux de s’être reconnu, nous nous crevons les yeux pour échapper à cette reconnaissance. S’aveugler de se voir, s’aveugler pour tout voir : tel est l’écart qui sépare le sujet tragique et le sujet du savoir. C’est une grande et bien terrible chose qu’un tragique sans tragédie.
Comme dans les jeux de miroir de La dame de Shangaï, l’énigme fuit à l’infini, dans le vertige d’une ambiguïté que la raison voudrait ignorer et qu’elle croit logiquement interrompre. Mais l’oracle dit vrai, et cette vérité déclare la supercherie du sujet du savoir, supercherie qui consiste à affirmer une norme autoconstitutive de la vérité fondée sur la certitude de la conscience. Comme toute vérité oraculaire, elle éclaire l’histoire par-delà elle-même : le sujet moderne, héritier du jugement socratique, est en effet, cet homme, « l’homme le plus savant qui soit », lui qui s’ignore comme tel d’autant plus qu’il a cru pouvoir faire de son ignorance même, de son ipséité vide, la norme de toute vérité. Quelles que soient les ruses dont elle fasse preuve, la conscience n’échappe donc jamais à la « boiterie ». Peut-être parce qu’elle est, en son essence même, tragique.
La source s’est tarie. Un sujet du savoir est advenu. Aucune énigme ne peut renverser notre savoir. Nous sommes tout de n’être rien et n’avons pas à craindre la reconnaissance du destin. Mais peut-on encore devenir un homme ?
(23-11-2015)
Le grand renfermement platonicien (3) - Platon et la tragédie.
Mon projet est ici d’interroger les raisons qui motivent le rejet de la poésie par Platon dans La République. Le moins que l’on puisse dire est que ce rejet a suscité l’embarras de la plupart des commentateurs, les uns et les autres rivalisant pour en minorer la portée, à l’aune d’autres dialogues où la poésie est reconnue par le philosophe comme une inspiration capable d’élever l’âme et de la faire tendre vers la beauté et la vérité (Phèdre, Ion, notamment). Or, ces interprétations divergentes n’en rendent que plus « déconcertante » encore - selon le mot de Monique Dixsaut – la critique de la République, critique dont l’outrance est telle parfois que la même commentatrice peut ajouter : « L’attaque menée tout au long des trois livres de la République est le point où tout admirateur de Platon risque de se sentir trahi par lui » ; et d’ajouter : « elle constitue une source inépuisable de critiques envers la « censure » qu’il prétend exercer et elle semble être la preuve irréfutable de son « totalitarisme » ».[i] Bien sûr, Monique Dixsaut pointe à la suite le caractère exagéré, voire irrecevable, d’une telle lecture, relevant tous les indices qui, dans l’œuvre platonicienne, témoignent en faveur d’un Platon plus nuancé, moins farouchement hostile à la poésie qu’il ne semble l’être dans la République. Tel qu’elle le souligne, l’essentiel de la critique platonicienne des arts consiste à analyser les effets de la mimesis artistique, cette dernière recélant, selon ses mots, « un énorme danger éthique et politique » pour le philosophe, dans la mesure où l’âme humaine, mimétique par nature, est vulnérable aux modèles par laquelle on l’instruit et se laisse ainsi aisément éblouir par les histoires, même (surtout) les pires, dont on l’abreuve. Autrement dit, la critique des arts par Platon, et tout particulièrement de la poésie tragique, devrait s’entendre exclusivement dans les limites d’un dialogue qui pose la question de la paideia, de la meilleure façon d’instruire, de façonner l’âme humaine, et cela en vue de rendre possible et de parachever le seul ordre juste pour la Cité, à savoir l’ordre de la raison, cette paideia apparaissant à la fois comme la condition de possibilité de cette constitution juste mais aussi comme son accomplissement.
Outre cette limite, Platon ne devrait pas – toujours selon Monique Dixsaut – être tenu pour responsable de la mauvaise réception des œuvres tragiques ; ce serait surtout le fait de ses contemporains qui soit s’attachent uniquement à « la brutalité de leur contenu », soit font de l’héritage homérique une somme encyclopédique dans laquelle ils pensent pouvoir naïvement puiser des connaissances positives. Autrement dit, la critique platonicienne de la République ne devrait s’entendre que dans les limites d’un contexte historique peu favorable à la juste intelligence des œuvres artistiques. Toutefois, la même commentatrice semble par la suite attribuer une portée beaucoup moins accidentelle à cette critique platonicienne, notant que « à travers son rejet de la poésie, c’est toute la culture de son temps que Platon refuse », rupture dont elle ressaisit le caractère problématique au travers d’un ensemble de questions : « De quelle vision cette culture est-elle l’expression ? Qu’est-ce qui imprime son unité à la diversité de ses manifestations ? (…) Si les Grecs ont fait des poètes et plus généralement des artistes leurs éducateurs, pourquoi l’ont-ils fait ? Quelle sorte de vérité sur le monde et eux-mêmes l’art exprimait-il, en laquelle ils se reconnaissaient ? »
Ces questions, disons-le, nous apparaissent beaucoup plus décisives pour affronter la portée et les enjeux de la critique platonicienne de la République. Car – et ce sera la thèse que nous soutiendrons, Platon prend en effet la décision dans cette œuvre de rompre radicalement avec la « vision tragique » de l’homme et du monde, rupture qui, loin d’être accessoire, est l’enjeu majeur du dialogue. Seulement, il nous semble impossible de réduire cette « vision tragique » à ce que Monique Dixsaut en dit, à savoir qu’elle consisterait en un « attachement excessif à la vie et une aversion insurmontable pour la souffrance et la mort », la critique platonicienne portant selon elle sur la pauvreté et l’aveuglement d’une représentation de la vie qui ignorerait toute dimension transcendante : « est tragique toute perspective qui juge, sans recul ni hauteur, la vie humaine digne du « grand sérieux » ».
Comment, en effet, Platon pourrait-il donner une telle ampleur à sa critique si les motifs en étaient si futiles ? Si, comme le souligne Platon au livre X, « il est ancien le conflit entre la philosophie et l’art de la poésie » (607b)[ii], c’est avant tout parce que ce sont deux conceptions divergentes de la vérité qui s’affrontent ici. Et il s’agit bien pour le philosophe de disqualifier cette autre vérité, tragique, incompatible avec l’ordre du logos, comme il le souligne peu après (608a), l’enjeu étant de montrer qu’ « il ne convient pas de s’appliquer sérieusement à la poésie de ce genre, comme si elle atteignait la vérité et constituait une activité sérieuse ». Une telle précision ne serait pas nécessaire si Platon n’estimait pas que le discours tragique peut se faire valoir comme une forme de vérité et qu’il est d’ailleurs compris ainsi par ses contemporains. Dès lors, si Socrate considère à la suite que ce conflit si « ancien » entre philosophie et poésie ne saurait se réduire à des invectives puériles, s’il s’agit de le considérer comme un « combat d’importance » (608b), c’est bien parce que la philosophie et la tragédie sont deux expressions concurrentes de la vérité, qui ne peuvent pas cohabiter.
Afin donc de cerner les raisons qui motivent l’exclusion par Platon de la tragédie, reprenons la question posée par Monique Dixsaut : quelle sorte de vérité sur le monde et sur eux-mêmes l’art exprimait-il, en laquelle les Grecs se reconnaissaient ? La question est d’autant plus pertinente que c’est contre une telle vérité tragique que Platon, ainsi que nous l’avons souligné, construit son propre modèle de vérité ou – plus justement encore – c’est sur cette vérité, sur son rejet sans appel, qu’il arcboute sa propre conception de l’Etre et de la condition humaine.
En ce sens – et au contraire de ce que bien des commentateurs pourraient nous laisser croire, la critique de l’art et de la tragédie déborde les cadres d’une simple censure morale selon des exigences pédagogiques et politiques dont Platon nous expose ici les principes. Oui, Platon est un censeur, mais ne le « christianisons » pas à outrance ; ce n’est pas un « petit » inquisiteur ni un tâcheron qui s’efforcerait uniquement de prescrire des bonnes mœurs. La souveraineté politique dont il cherche à fonder les principes est une souveraineté qui procède d’une certaine compréhension de l’Etre, et c’est cette compréhension de l’Etre dont procède systématiquement dans la République la critique des effets de la mimesis tragique, notamment le désordre émotionnel dont elle est la cause. La nocivité éthico-politique de la tragédie est donc l’effet remarquable d’une illusion ontologique : la première est le signe de la seconde ; la seconde est la raison essentielle de la première. C’est donc au nom de l’Etre, d’une certaine logique et d’une certaine ontologie, qu’il faut faire taire les tragiques, car – et c’est bien ce qu’il s’efforce de mettre en évidence dans ce dialogue – la vision tragique du monde condamne l’homme à l’errance et à l’hubris, éthiquement et politiquement. C’est ainsi qu’au fil de sa critique, il ne cesse de rappeler sa propre logique et sa conception de l’Etre pour mieux disqualifier à la suite l’interprétation tragique du réel. Si les commentateurs n’ont guère prêté attention à cet emboîtement ontologico-politique de sa critique de la tragédie, c’est peut-être parce que cette logique et cette ontologie étaient (bien mieux) élaborées dans les dialogues antérieurs et que Platon ne fait ici qu’en réitérer les principes connus, semblant plus s’attacher à la poesis souveraine et à ses effets psychosomatiques. Or, c’est pourtant sur le fonds de cette ontologie que l’on peut mesurer la portée du discrédit de la tragédie, que Platon cherche à rendre effectif, car l’artisan politique est avant tout le gardien de l’Etre et il veut façonner les hommes à l’imitation de cet Etre.
Reformulons donc la question de Monique Dixsaut pour bien mesurer la portée du geste platonicien : quelle est ainsi la conception de l’Etre, portée par la tragédie, que Platon entreprend de disqualifier dans la République ?
Cette vision tragique de l’Etre se dessine en creux de la propre ontologie et logique à laquelle Platon l’oppose et qu’il rappelle afin d’en amorcer la critique. Ainsi, au début du Livre X, Socrate commence, sans s’y appesantir, par renouveler le principe logique qui fonde toute l’épistémologie platonicienne : « Eh bien, veux-tu que nous commencions notre examen en partant de ce point-ci, selon notre méthode habituelle ? Nous avons, en effet, l’habitude de poser en quelque sorte une forme unique, chaque fois, pour chaque ensemble de choses multiples auxquelles nous attribuons le même nom » (596a). «L’habitude » dont il est ici question nous renvoie bien sûr à tout le travail d’élaboration logique des dialogues antérieurs, où était articulée une double nécessité logico-ontologique, celle d’un discours-un portant sur un Etre-un, unité et unicité apparaissant à la fois comme la condition de la vérité et de l’Etre. Notons au passage le remarquable « lapsus » que commet Platon à la suite, puisque, de cette « méthode habituelle », il en déduit une certaine production démiurgique de l’Etre, laissant alors penser à raison que ce n’est pas la logique qui, dans son système de pensée, se subordonne à l’Etre mais plutôt l’Etre qui se déduit d’une certaine « habitude » logique.
Or, c’est bien cette unité et cette unicité de l’Etre que la mimesis de l’art trahit car, en effet, cette re-production qui ne produit rien, en redoublant les choses, les dédouble illusoirement, ce qui sème la multiplicité dans l’Etre et la duplicité dans le discours. Si Platon pointe ainsi l’effet illusoire de l’art du peintre en comparant son œuvre à un « miroir » tendu vers le réel (596e), ce n’est pas ainsi pour disqualifier l’esthétique (de son époque) en la caricaturant (ce à quoi on a souvent réduit ce passage, de façon bien anecdotique). Il s’agit plutôt de ramener la mimesis à son geste et à sa forme purs, qui sont, quelles que soient les règles auxquelles obéit un artiste et les choses qu’ils imitent, quelle que soit aussi l’exigence de vérité qui l’anime, de rendre double ce qui était un. Voilà l’effet principal de la mimesis : elle dissémine l’Etre et le rend autre que lui-même. Car ce que figure la mimesis c’est un Même qui, loin de fonder l’identité à soi de l’Etre, au contraire, l’oppose à lui-même. Et c’est là l’effet pour le moins pernicieux de la mimesis dont Socrate veut nous faire prendre conscience : l’altérité ici ne procède pas de la différence mais se loge paradoxalement au cœur même de la ressemblance. L’effet mimétique par excellence – terriblement tragique, comme nous le verrons, sème ainsi la confusion dans l’ordre logico-ontologique : le Même produit l’Autre, non comme son autre, mais comme la conséquence paradoxale de la ressemblance à lui-même, nous condamnant dès lors à rechercher l’identité de toutes choses dans un redoublement qui, immanquablement, les rendent autres qu’elles-mêmes.
C’est pourquoi il me semble que l’on ne peut pas comprendre le rejet définitif de la mimesis de l’art au terme du dialogue, là où les premiers livres pouvaient nous laisser croire que Platon envisageait la possibilité d’une « bonne » mimesis, si l’on ne tient pas compte de la façon dont, dans le Livre X, son effort pour la définir dans sa forme pure le conduit à la reconnaître ainsi comme l’origine de toute illusion. Que l’illusion procède essentiellement de la mimesis, c’est bien d’ailleurs ce que Socrate figure quand il évoque le « miroir » du peintre, en laissant sciemment entendre que cette reproduction prétend se faire valoir comme une production authentique (« Très vite, tu produiras le soleil et les astres du ciel, et aussi rapidement la terre, rapidement toujours toi-même et les autres animaux, et les meubles et les plantes, et tout ce dont on parlait à l’instant »). Bien sûr, cette erreur Socrate ne la commet que pour mieux rendre sensible à son interlocuteur l’effet illusoire qui procède de toute mimesis, ce à quoi Glaucon ne manque d’ailleurs pas de réagir aussitôt, relevant que la mimesis est une pseudo-production, qui produit des apparences mais non pas « des êtres qui existent véritablement ».
L’agencement des arguments mérite, ô combien, que l’on s’y arrête. Car Platon rapporte ici très clairement l’illusion, non pas à l’apparence de l’Etre lui-même, à son apparaître, mais à la façon dont notre sensibilité « produit » ces apparences en se rendant disponible à ce qui apparaît, multipliant ainsi toutes choses en les redoublant et croyant toucher l’Etre quand elle n’atteint que ses propres apparences, celle qui procède de l’acte même par lequel elle accueille ce qui est. En effet, si Glaucon oppose les apparences illusoires à l’existence véritable, cette distinction, notons-le, se rapporte à l’apparence que produit illusoirement la mimesis, et non pas à l’apparence des choses mêmes, si tant est que celle-ci puisse d’ailleurs être perçue hors d’une sensibilité mimétique qui lui substitue ses pseudo-productions. Autrement dit, le problème que Platon ne cesse d’affronter dans toute son œuvre, celle de la connaissance de l’Etre, de la distinction de l’Etre véritable et de l’illusion, se pose parce que nous sommes des êtres mimétiques et parce que notre sensibilité, foncièrement mimétique, « double » l’Etre et lui substitue ses propres apparences. Ainsi, bien avant la pensée moderne, Platon a affronté au travers de la question de la mimesis, les ambiguïtés et les paradoxes de toute représentation, et conçu une sensibilité, non pas passive, mais active, interprétative, pour qui « imiter » c’est produire l’apparence des choses sous la forme d’une multiplicité sans limite.
Car il est un « miroir » autre que l’art, une autre mimesis qui reflète le réel et l’oppose à lui-même, dont la mimesis du peintre est tributaire et dont elle n’est que le prolongement et l’approfondissement : celle de nos sens qui réfléchissent chaque chose et les font autres qu’elles ne sont, les séparant d’elles-mêmes en les réfléchissant, produisant la multiplicité, non par la différence, mais par la ressemblance. Si Socrate, en ce sens, caractérise la mimesis du peintre par le « miroir », c’est pour mieux signifier la continuité entre cette imitation et celle, première, de notre sensibilité. Nous sommes tous des peintres, en ce sens, et toute sensibilité est foncièrement artiste : bien avant que le peintre tende son miroir face au réel, le « miroir » de l’œil est mimesis, non dans le sens où notre sensibilité réfléchirait ce que sont les choses et pourrait nous en donner une représentation adéquate, mais dans le sens où les images sensibles multiplient et divisent l’Etre, au moment même où elles semblent en réfléchir l’unicité. En ce sens, aucune perception adéquate du réel n’est jamais possible. Sentir, c’est immanquablement introduire (si l’on nous permet l’emploi de ce concept épicurien appliqué à Platon) une déclinaison dans l’Un de l’Etre ; toute vision sensible est torse, déviée, par nature. « Les mêmes objets, selon qu’on les observe dans l’eau ou hors de l’eau, paraissent fracturés ou droits, et aussi concaves ou convexes, suivant une autre illusion optique qui est l’effet des couleurs » (602d). Or, sont-ce les choses mêmes qui produisent cette illusion ? Non, répond Socrate, « évidemment tout trouble de cette nature réside lui-même dans notre âme ». C’est notre âme qui double le réel, le divise et l’oppose à lui-même, trahit les choses en les multipliant alors qu’elles sont simples. Car telle est bien la forfaiture et l’illusion dont notre sensibilité mimétique est d’elle-même porteuse : générer le multiple et l’Autre au cœur même de l’Un et du Même, quand tout l’effort de la dialectique philosophique est au contraire de traverser la multiplicité pour rejoindre l’unité de l’Etre, afin de la lui subordonner et de garantir l’unité différenciée de l’Un et du Multiple, du Même et de l’Autre, en empêchant qu’ils se contaminent et se confondent. Voir, c’est donc voir « double », c’est produire l’Autre en visant le Même, enfanter le multiple de l’Un. Cette génération illusoire est de même rapportée par Socrate à la sensibilité, dans le fameux exemple du lit : « Un lit, note-t-il, si tu le regardes sous un certain angle, ou, si tu le regardes de face, ou de quelque autre façon, est-il différent en quoi que ce soit de ce qu’il est lui-même, ou bien paraît-il différent tout en ne l’étant aucunement ? » (598a). Dès lors, le seul moyen, nous dit Socrate, de mettre un terme à cette folle et factice génération sensible, qui introduit l’altérité et la multiplicité dans la réalité, c’est de la confondre par la rectitude de « la mesure, [du] calcul et [de] la pesée » (602d). Le dialecticien se veut ici le gardien de l’intégrité et de la simplicité de l’Etre contre une mimesis qui l’entraîne sur la voie d’un devenir contradictoire.
Toute image donc, toute représentation sensible est tronquée, partielle ; pour le dire à la manière « grecque » et « archaïque », elle introduit la boîterie dans l’Etre – or on verra par la suite l’importance que Platon accorde à ces prédicats « archaïques » pour mieux marquer sa rupture avec les compréhensions anciennes de la vérité dont la conscience tragique est héritière. Voir, c’est immanquablement voir le Multiple dans l’Un, le Même et l’Autre en même temps, voir à chaque fois différemment le même lit et le voir différemment parce qu’il est paradoxalement le même. Mais – et c’est là que le jeu de la mimétique sensible peut être interrompu, dépassé, ce dont la dialectique est l’exigence – si notre sensibilité produit d’elle-même l’illusion en reflétant l’Etre, il n’en demeure pas moins que cette mimesis trahit toujours sa dette envers l’unité de l’Etre au moment même où elle semble le multiplier à l’envi. Car le miroitement de l’Etre n’est sensible qu’en tant qu’il est perçu sur le fonds d’une évidence ontologique qui le subsume, à savoir l’unité et l’unicité de chaque être dont procède le multiple.
Dès lors, notre sensibilité ne nous éloigne jamais à ce point de la réalité que l’ordre de la production véritable (celle du démiurge) ne puisse pas être retrouvé ; aucun « malin génie » ne peut faire ainsi que nous puissions percevoir le multiple, les apparences mouvantes de l’Etre, en dehors de l’horizon d’une unité et d’une unicité qui, seules, leur donnent une teneur et les font être ce qu’elles sont : de simples apparences. En ce sens, si l’illusion est première en nous parce qu’elle est congénitalement liée à notre sensibilité mimétique, elle n’en demeure pas moins tributaire d’une production qui la détermine et dans laquelle s’inscrit toute génération possible, celle de l’Un. Aussi kaléidoscopique soit-elle, la perception trahit dès lors dans son mouvement même, et tant que ce mouvement perdure, l’identité foncière de toute chose à elle-même. En dédoublant l’Etre, notre sensibilité ne peut ignorer la vérité ontologique qui sous-tend le jeu d’apparences auquel elle se complaît : son dédoublement (n’) est (qu’) un redoublement ; aussi divers que nous apparaisse le réel, entraîné dans le tourbillon chatoyant de notre sensibilité, l’Un qui rend possible le Multiple, ne le devient jamais.
Or la forfaiture de l’art du peintre consiste justement, selon Platon, à donner droit à la réalité du Multiple sensible, en fixant l’apparence, en la coupant autrement dit du mouvement qui déterminait sa génération et qui rendait sa production tributaire de l’Un. Mimesis de la mimesis sensible, l’art n’est pas une imitation qui fait signe vers le réel dont elle serait tributaire en tant que simple apparence, cette imitation confère au contraire aux apparences la valeur d’une réalité en soi et nous les fait ignorer comme simples signes des choses. Autrement dit, si la multiplicité de l’expérience sensible fait toujours signe vers l’Etre-un, la mimesis de l’artiste vient briser ce lien qui faisait du multiple et de l’apparent de simples prédicats de l’Etre. L’iconoclastie de Platon vise ainsi essentiellement à dénoncer cette usurpation dont l’art est pour lui le nom, usurpation qui consiste à donner réalité à ce qui n’est qu’apparence, à produire des simulacres, c’est-à-dire à transformer des ombres en des choses. Et si Socrate insiste tant sur le caractère de simples simulacres de l’art du peintre (598b- 599b), c’est bien afin de dénier à sa production la possibilité de s’affirmer comme l’expression à rebours de l’œuvre du démiurge, son négatif monstrueux : car si la production véridique et divine réduit le multiple à n’être jamais que le rejeton de l’Un, et tel que le Multiple nous y ramène toujours docilement, la pseudo-production de l’artiste, sa mimesis, prétend produire le multiple comme un Etre et conférer une réalité ontique aux apparences. C’est pourquoi l’argument majeur de Socrate contre la reconnaissance d’une vérité des œuvres d’art passe par la contestation de leur réalité elle-même. Il faut en effet les contenir absolument dans l’ordre de l’apparence en en faisant des illusions, pointer tout ce qui en elles les réduit à n’être que des demi-réalités, reflet imparfait et partiel d’un Etre qu’elles ne peuvent jamais que doubler par jeu et qui fera d’elles au mieux des trompe-l’œil, puérils et fugaces, jamais des réalités à part entière. L’art du peintre, nous dit Socrate, « est éloigné du vrai » parce qu’il ne peut en atteindre « qu’une petite partie, et cette partie n’est elle-même qu’un simulacre » et certes, s’il est talentueux, « il trompera les enfants et les gens qui n’ont pas toutes leur facultés en leur montrant de loin le dessin qu’il a réalisé d’un menuisier, parce que ce dessin leur semblera le menuisier réel » (598c).
Comme nous le relevions, cette interprétation de l’art pictural par Platon a souvent été comprise de façon anecdotique, soit qu’on lui reproche de réduire l’art à une simple imitation, au sens moderne du terme, soit qu’on renvoie sa critique à l’état déliquescent de la peinture grecque à son époque. Or, si de fait ce jugement est trivial, il n’en est pas moins la conséquence nécessaire de toute l’ontologie platonicienne. Comment, en effet, Platon pourrait-il garantir l’ordre hiérarchisé de l’Un et du Multiple, de l’Etre et des apparences, en reconnaissant à ces dernières la possibilité de se faire valoir comme des réalités pleines et entières ? Comment préserver le lien qui, dans sa pensée, unit jusqu’à la confusion le réel et le vrai, si le sensible devient une chose et les choses deviennent des signes ? Si une telle mimesis de la mimesis n’est pas contestée et interrompue, elle emportera avec elle toute réalité dans un tourbillon fractal sans fin, celle-ci n’étant plus alors en effet que la réalité des apparences, qui ne sont elles-mêmes que l’apparence d’autres apparences, sans que jamais il soit possible de distinguer ce qui est vraiment de ce qui n’est pas. Dès lors, c’est avant tout parce que la mimesis de l’artiste rend la réalité problématique, brisant la ligne claire et simple qui lie les apparences sensibles à l’Etre-un, qui fait de la réalité la norme de la vérité, et réciproquement, que Platon s’efforce de la disqualifier si précisément. Car, par le geste de l’artiste, les apparences cessent de faire signe vers l’Etre pour se faire valoir elles-mêmes comme réelles. En ce sens, ce n’est pas uniquement en vertu d’un détour allégorique que la question de la vérité prend la forme d’un « théâtre d’ombres » dans la Caverne : l’illusion est un problème avant tout esthético-politique et non pas ontologique, car c’est l’œuvre des « montreurs de marionnettes », sophistes et artistes, qui contraint le philosophe à repenser la vérité en termes de véridicité. Il ne suffit plus, en effet, de gager la vérité sur la seule réalité qui vaille, celle de l’Etre, pour prémunir la connaissance de l’illusion, comme le faisait les dialogues antérieurs. Parce que la mimesis de l’artiste confère une réalité aux apparences, la question de la vraisemblance du réel se pose alors et il devient nécessaire en retour de plier la réalité à l’exigence de vérité, ainsi que Platon l’entreprend dans la République.
Comprenons ainsi que la question de l’art, loin d’être anecdotique pour le philosophe, est bel et bien ce qui l’entraîne à faire de la vérité, non un simple problème épistémologique, mais une question essentiellement politique, la vérité de l’Etre devant être défendue contre tous ceux qui produisent une réalité factice. Platon, dans ce dialogue, se veut ainsi le gardien de l’intégrité du réel au nom de la vérité. Mais cela n’allait pas sans risque – et c’est sans doute là le cœur du « malaise » qu’éprouvent les commentateurs face à la censure platonicienne : comment, en effet, continuer de soutenir encore le lien qui unit ontologiquement la vérité et le réel, si la vérité doit, pour ce faire, se transformer en une norme et une violence politiques, qui suppriment toutes les présences qui sont contraires à son exigence, ou qui leur dénient toute réalité, en les rejetant dans l’illusion ? Platon, pas plus que tout autre, peut-être même le premier de tous, n’échappe pas à l’ambiguïté et aux contradictions du penseur lorsque celui-ci se fait souverain et veut convertir « sa » vérité en lois.
Il nous faut maintenant affronter notre question de départ : pourquoi Platon accorde-t-il tant d’importance à la tragédie et consacre-t-il une part essentielle de son dialogue à justifier son bannissement de la Cité ? Il est certes de coutume, parmi les commentateurs, de « faire le tri » parmi les arguments platoniciens afin de pouvoir rassembler cette pensée en un corps de doctrine. Mais si l’on est attentif au déroulement de sa pensée, on remarquera que c’est essentiellement la critique de la tragédie, de la vision tragique et de ce qu’on pourrait appeler la « Cité tragique », qui conduit sa réflexion à partir du Livre II et qu’il mène jusqu’à à sa conclusion au Livre X. Autrement dit, la conception politique que Platon se fait de la Cité idéale est le contrepoint de la Cité tragique, dont il contredit le modèle. La première est l’exact envers de la seconde. Or, si en dépit de la logique de son argumentaire, qui est arcbouté sur le problème de la tragédie, la critique insistante de Platon n’en a pas moins embarrassé les commentateurs, c’est avant tout parce que les raisons qu’il nous donne d’un tel rejet renvoient à une expérience spécifiquement grecque de la tragédie, dont l’évidence aujourd’hui nous fait défaut. Je veux dire par là que nous sommes toujours susceptibles face à cette œuvre d’ignorer les arguments du penseur, quelque importance qu’il semble leur accorder lui-même, parce que leur sens achoppe sur l’impossibilité pour nous de vivre, et pas simplement de se représenter, la tragédie telle qu’elle imprégnait la culture grecque, déterminant une certaine expérience du monde et de soi-même.
Au fond, nous ressemblons par bien des aspects à l’Averroës de la merveilleuse nouvelle de Borges[iii] : de même que l’Averroës de Borges n’arrive pas à comprendre ce dont parle Aristote dans la Poétique, faute de pouvoir faire l’expérience de la représentation théâtrale, de même la portée des arguments de Platon nous échappe parce que la vie tragique nous est aujourd’hui inconnue. Bien sûr, nul commentateur de Platon n’ignore – et je n’aurais pas l’impudence de soutenir le contraire – que l’art tragique jouait un rôle central dans la culture grecque, étant à la fois le creuset de toutes les connaissances communes, un moment décisif de la vie politique et surtout la façon dont les hommes affrontaient la vérité de leur condition dont l’éclat problématique surgissait soudain au miroir de la tragédie. Mais, tout en le sachant, nous l’interprétons – sans même en avoir la claire conscience – comme une représentation, un simple spectacle, à la manière de ce que le théâtre allait devenir plus tard, ne mesurant plus dès lors à quel point le tragique était un modus vivendi pour les Grecs, une façon d’être au monde, de le vivre et de le comprendre. En un sens, on pourrait dire que nous sommes plus platoniciens que Platon lui-même ou que notre compréhension de l’art marque dans une large mesure le triomphe de sa critique – le christianisme ayant sur ce point, comme sur bien d’autres, parachevé l’entreprise platonicienne. Certes, nous n’avons pas banni les artistes de la Cité mais, si nous sommes prêts à rétrocéder une part de vérité aux œuvres d’art en marge des sciences, nous ne leur reconnaissons jamais « sérieusement » la dignité d’être des formes de savoir authentique et encore moins celle d’être le creuset de notre questionnement politique ; quant à leur capacité de signifier l’énigme qu’est notre humanité, nous le leur concédons sans peine, l’humanité ayant depuis longtemps cessé de s’estimer comme le nom d’une énigme, hormis par jeu, métaphore et poésie.
On ne saurait ainsi mesurer la portée de la critique et du rejet platoniciens si nous ne nous faisons pas une idée, aussi vivante possible, de ce qu’était la vision tragique, telle que les arguments développés par Platon la visent précisément. La philologie nous apporte ici une aide précieuse et notamment les travaux de Jean-Pierre Vernant qui mettent remarquablement en lumière ce qui se jouait au cœur de la Cité tragique. Quelle était donc l’expérience de soi et du monde que les Grecs faisaient et à laquelle ils donnaient le nom de tragédie ? Comme Vernant le souligne avec force, « l’effet tragique ne réside pas dans une matière, même onirique, mais dans la façon de mettre cette matière en forme pour donner le sentiment des contradictions qui déchirent le monde divin, l’univers social et politique, le domaine des valeurs, et faire ainsi apparaître l’homme comme un thaûma, un deinon, une sorte de monstre incompréhensible et déroutant, à la fois agent et agi, coupable et innocent, maîtrisant toute la nature par son esprit industrieux et incapable de se gouverner, lucide et aveuglé d’un délire envoyé par les dieux ».[iv] Lisons comme il se doit ce qu’écrit ici Vernant : l’énigme qu’est l’homme, ce qui fait de lui « un monstre déroutant et incompréhensible » selon le chœur de l’Antigone de Sophocle, ce n’est pas qu’il puisse être successivement ou alternativement agent ou agi, coupable ou innocent, lucide ou aveuglé, mais qu’il soit « à la fois », dans le même temps, l’un et l’autre.
Héritière de toute la
pensée archaïque, la vision tragique de l’homme et du monde nous met
ainsi face à une fondamentale ambiguïté de toutes choses et de la
condition humaine. Tout est double et cette duplicité, qu’aucune
dialectique ne peut dissiper, est la vérité même de l’Etre, un Etre
bigarré, chatoyant, mouvant, dont la richesse se signifie par cette
multiplicité contradictoire et irréductible. Approcher le réel et en
avoir l’intelligence pour cette pensée archaïque et tragique, c’est
affronter ce jeu sans fin où le Même et l’Autre sont conjoints et
échangent leurs attributs, où la confusion des ordres, épistémique,
politique ou éthique, fait surgir une vérité qui n’a rien de la clarté,
de la distinction et de la simplicité, à laquelle on l’identifiera plus
tard – héritiers que nous sommes de Platon – mais qui brille au
contraire d’un éclat bien plus trouble, bien plus sombre et déroutant,
celui des énigmes. Comme le note ailleurs Jean-Pierre Vernant, « sur
le plan de l’expérience humaine, avec l’avènement de ce qu’on peut
appeler une conscience tragique, l’homme et son action se profilent, non
comme des réalités stables qu’on pourrait cerner, définir et juger, mais
comme des problèmes, des questions sans réponse, des énigmes dont les
double sens restent sans cesse à déchiffrer ». Plus équivoque
qu’aporétique, l’énigme tragique ne se laisse pas circonscrire ni
subsumer par une raison triomphante : la vérité ici n’est pas l’effet
d’un logos expert, capable de l’enchaîner dans les rets de ses
catégories ; elle est au contraire ce qui conduit la pensée au seuil de
son propre vertige, là où elle doit affronter la duplicité de toute
parole et de toute signification. Miroir de l’Etre, le logos ne
l’est pas ici en tant qu’il en réfléchirait son unité et sa clarté : la
tragédie fait saillir au contraire la part trouble, la confusion, qui se
loge au cœur de toute parole, les double sens qu’elle porte sans jamais
pourtant pouvoir clairement les entendre, l’ombre de toutes nos
significations. A l’instar du Protagoras de Platon, tout tragique
pourrait sans doute dire : « Aucune chose prise en elle-même n’est
une »[v].
Seulement, à la différence des sophistes, cette ambiguïté et ces
contradictions qui condamnent notre pensée à des paralogismes incessants
et la retournent contre elle-même, les tragiques n’en font pas les
signes d’une illusion dont nous serions prisonniers et qui réduirait la
parole à un usage cynique. Si cette duplicité se loge au cœur du
logos, elle n’est pas toutefois le signe d’une parole impuissante,
confuse, qui jamais ne pourra approcher l’Etre et le dire sciemment,
comme le pensent les sophistes. Si toute parole est clivée, c’est au
contraire parce qu’elle réfléchit le trouble de l’Etre, son
apparaître et son mouvement, parce qu’elle est le miroir de sa vérité
énigmatique, de son chatoiement incessant. En ce sens, les poètes
tragiques sont des adversaires bien plus inquiétants que les sophistes,
bien plus susceptibles de menacer l’ontologie platonicienne, car si les
seconds réduisent les ambiguïtés du logos à des jeux rhétoriques,
tout juste bons à produire la persuasion, les premiers font de ces
ambiguïtés la vérité même de l’Etre. Dans la tragédie se fait encore
entendre la voix de la vérité archaïque, celle-là même que Platon veut
exténuer.
C’est bien ainsi la critique de cette vision tragique de l’Etre et de la condition humaine qui traverse La République, qui est, peut-on dire, le fil conducteur de sa réflexion. Si Platon n’a de cesse de contester le savoir des poètes tragiques, c’est afin de rejeter cet art lui-même hors du domaine de la vérité et afin de dépouiller la vision tragique de sa puissance oraculaire. Contester à la tragédie toute vérité, c’est avant tout pour le philosophe s’efforcer de vider le kaïros tragique de sa charge d’expression et de révélation. Qu’entendons-nous par « kaïros tragique » (et que nous prenons la liberté de nommer ainsi) ? Comme on le sait, les Grecs désignaient sous le nom de kaïros l’occasion favorable, le temps opportun de l’action, qui est toujours de l’ordre de la rencontre, qui ne peut jamais devenir l’objet d’une science certaine et que seul peut accueillir et reconnaître celui qui est doué de métis, cette intelligence qui épouse le mouvement de l’Etre et sait s’en saisir par ruse, tours et détours. Si nous hasardons l’expression de « kaïros tragique », c’est afin de profiter des vertus de l’analogie, tout en n’ignorant pas les limites d’un tel déplacement de sens. De même en effet que, dans l’ordre de l’action, le kaïros est le signe d’un temps aussi imprévisible qu’opportun, qui, soudain, suspend la prééminence du nécessaire sur le contingent, de même toute tragédie est une sorte de kaïros, une occasion critique où l’homme va à la rencontre de lui-même et fait face à l’ambiguïté de son destin ; toute tragédie est ce « moment opportun » où se précipitent les contraires, où vacille l’ordre de leur différence, où nous sommes soudain démunis face à des contradictions et des ambiguïtés que toute notre science et notre logique ne peuvent démêler. Il est un kaïros de la vérité, comme il existe un kaïros de l’action, ce moment où, pour reprendre une définition de Pierre Aubenque, « le cours du temps, insuffisamment dirigé, semble comme hésiter et vaciller, pour le bien comme pour le mal de l’homme »[vi]. Mais – et c’est là que l’analogie prend fin, nulle intelligence héroïque ne peut triompher du kaïros tragique ; l’éclat de la vérité énigmatique qui se révèle ici ne se laisse pas subsumer dans l’action ; au plus loin du héros épique, le héros tragique est enfermé dans un cercle de contradictions et d’ambiguïtés dont il ne peut sortir, et l’action se renverse incessamment en impuissance, le savoir en ignorance, la réalité en illusion. Le chatoiement de l’Etre se fait ici prison, prison de glaces, où, en miroir, l’Etre se dédouble, où le Même se réfléchit dans l’Autre, où l’Un devient multiple, où les contraires ne s’appellent pas simplement, mais sont conjoints, à tel point que vouloir l’un, c’est aussi vouloir l’autre.
Or, c’est cette « occasion » tragique que Platon veut vider de son sens, en contestant que la vérité puisse ainsi se faire énigme et entraîner le logos dans le vertige des ambiguïtés qu’il portait en lui et qu’il ignorait. Contre les apories de la tragédie, la République se veut une entreprise systématique de clarification, comme nous allons le montrer. Ce que veut ainsi le philosophe, c’est démêler l’écheveau du discours tragique, en dénoncer les artifices, démystifier cet art afin de tirer la vérité hors de la scène énigmatique où les poètes la convoquent. Cette entreprise de démystification est au cœur de la fameuse définition que Platon propose de la tragédie au Livre X (603c-603d) : « L’art imitatif [en quoi consiste la poésie tragique] représente, disons-nous, les êtres humains engagés dans des actions qui sont ou bien forcées, ou bien accomplies de leur plein gré. De la réalisation de ces actions, ils tirent un sentiment d’avoir réussi ou d’avoir échoué et, dans chaque cas, ils éprouvent soit de la peine, soit de la joie ». Bon nombre de commentateurs convoquent cette définition platonicienne de la tragédie comme s’il s’agissait d’une définition « neutre » ou a minima de la tragédie, telle qu’on pourrait d’ailleurs l’interpréter comme l’exacte description de l’action tragique. Or, c’est ignorer tout simplement le glissement de sens que Platon cherche ici à produire et qu’il a d’ailleurs patiemment préparé auparavant (602c-603c). Une telle définition, si l’on y prend garde, tend à retirer toute charge énigmatique à l’action tragique. La part d’ambiguïté, qui est au cœur de cette action, est en effet soumise ici à une « bifurcation » dialectique, qui tend à démêler l’énigme tragique, qui cherche à rétablir la différence des contraires, quand la tragédie, elle, figure leur unité inquiétante. Lisons précisément la définition de Platon : il nous dit que la tragédie représente « les êtres humains engagés dans des actions qui sont ou bien forcées, ou bien accomplies de leur plein gré », puis, par voie de conséquence et selon un ordre de bifurcation logique qui déduit de cette première alternative des effets nécessaires, que ces hommes « de la réalisation de ces actions, tirent un sentiment d’avoir réussi ou d’avoir échoué », ce qui, tout aussi nécessairement, engendrent en eux « soit de la peine, soit de la joie ». Mais est-ce bien cela que représente l’action tragique ? La tragédie ignore de telles alternatives, si claires, si simples. Le problème du héros tragique, ce n’est pas qu’il hésite entre l’un et l’autre, ce n’est pas que ses actions puissent être ou bien forcées ou bien accomplies de plein gré, qu’elles puissent réussir ou échouer. La tragédie nous entraîne au-delà de cette logique-là, celle du ou bien/ ou bien, elle nous fait aborder des territoires où une telle logique devient inopérante, où la raison qui tranche, divise et sépare devient impuissante. L’action est tragique quand agir de plein gré, c’est aussi agir contre son gré, quand le héros échoue d’avoir réussi et réussit quand il échoue, quand il n’y a plus joie d’un côté, peine de l’autre, mais que surgit soudain ce sentiment à nul autre pareil, que nous nommerons tragique, où, dans notre regard penché sur l’abîme, se condense une émotion impossible, mêlant la joie, la peine, le plaisir, la douleur, l’effroi et la fascination. Séparer ainsi ce qui est fondamentalement intriqué dans la situation tragique, en réduire l’action à des alternatives, est une façon délibérée pour Platon d’empêcher que l’énigme tragique puisse prendre. Ainsi définie, l’action ne pourra jamais en effet éclater dans sa dimension tragique, dans le moment de la « reconnaissance » tragique, ce kaïros où, soudain, le Même et l’Autre s’unissent, se réfléchissent et se renversent l’un dans l’autre.[vii] En réduisant la tragédie à la logique des contraires, en substituant l’alternative à l’ambiguïté, en rationalisant ce qui est énigme, Platon transforme la tragédie en drame.
Qu’il ne s’agisse pas pour lui de proposer une définition « simple » de la tragédie mais bien d’en désamorcer la charge énigmatique, est confirmé par l’argumentaire qui précède cette définition. En effet, la critique de la mimesis, mimesis du peintre et mimesis de notre sensibilité, qui occupe tout le début du Livre X a pour fin – comme nous l’avons montré – de réduire la duplicité de l’Etre à la simple illusion et de rétablir la logique dialectique des contraires. Si « les mêmes choses apparaissent [ainsi] simultanément contraires l’une à l’autre » (602 e), ce trouble n’est pas à rechercher dans les choses mêmes mais est la conséquence de la « vulnérabilité de notre nature » (602d) qui se laisse aisément subjuguer par le jeu des apparences. Ainsi, il s’agit tout d’abord de rétablir les droits de l’Etre-un en rejetant toute ambiguïté et toute contradiction dans l’illusion, puis, à la suite, de rapporter l’origine de cette illusion à la partie sensible de l’âme, si prompte à se laisser abuser par les apparences (603d-604d). L’argumentaire est –il faut bien l’avouer – très habile, car si Platon nie toute duplicité en l’Etre, il ne nie pas pour autant l’expérience que nous en faisons, la logeant dans la partie irrationnelle de l’âme.
Ce souci de partition, partition de l’Etre, des fonctions de l’âme et des fonctions sociales, qui conduit la réflexion du philosophe d’un bout à l’autre de la République, a ainsi pour fonction essentielle de neutraliser la vision archaïque et tragique de l’Etre et de la condition humaine. Ce n’est pas un hasard, en ce sens, si cet effort dialectique, pour ordonner et diviser conjointement l’Etre et l’âme, trouve son expression dans le symbole de la Ligne au Livre VII. Cette dernière figure, en effet, la rectitude et la simplicité de la raison philosophique, tout entière dirigée contre la pensée tragique, cette pensée où tout fait cercle, où l’oblique et le tortueux déjouent le droit, où tout se dédouble et se mêle, où ce n’est pas l’ordre hiérarchisé qui exprime le réel mais l’équivocité, la métamorphose et le miroitement des contraires. La façon dont Jean-Pierre Vernant, dans Les ruses de l’intelligence, caractérise les valeurs qui définissent le monde de la mètis, peut ainsi parfaitement s’appliquer aux enjeux de la Ligne platonicienne : « Cette expérience semble avoir profondément marqué tout un pan de la pensée grecque. Les traits essentiels de la mètis que nos analyses ont dégagés : souplesse et polymorphie, duplicité et équivoque, inversion et retournement, impliquent certaines valeurs attribuées au courbe, au souple, au tortueux, à l’oblique et à l’ambigu, par opposition au droit, au direct, au rigide et à l’univoque. Ces valeurs culminent dans l’image du cercle, lien parfait parce que tout entier retourné et refermé sur lui-même, n’ayant ni début ni fin, ni avant ni arrière, et que sa rotation rend à la fois mobile et immobile, se mouvant en même temps dans un sens et dans l’autre ».[viii] C’est bien ce « cercle », en effet, que la rectitude de la Ligne du Livre VII cherche à percer, l’expérience de l’Etre que figure la métis étant inséparable du monde archaïque dont la tragédie perpétue la vérité et les formes. Ainsi, les clivages symboliques qui sont continuellement en œuvre au fil de la réflexion de Platon révèlent à quel point sa critique de la tragédie vise avant tout un certain régime de vérité et une certaine expérience de l’Etre, propre à la pensée archaïque.
Relevons-en quelques-uns des nombreux indices. Quand le philosophe, au Livre X, tire les conclusions de sa critique de la mimesis, il condamne cette dernière à la partie irrationnelle de l’âme, réduisant la tragédie à n’être que le hochet de nos sens, eux qui sont si prompts à se laisser séduire par des jeux illusoires. Or les termes employés par Platon sont loin d’être choisis au hasard : « Il y a, dit Socrate, l’élément qui est disposé à une imitation multiple et bariolée, c’est l’élément excitable, et d’autre part le caractère réfléchi et serein, toujours égal à lui-même. » (604e). L’épithète poikilos, par lequel Platon désigne ici l’imitation illusoire de la tragédie, se rattache à toute une tradition archaïque dont Jean-Pierre Vernant et Marcel Détienne ont remarquablement exploré les formes. Si Platon l’emploie ici en un sens clairement péjoratif, sa connotation était originellement tout autre. Pour l’expérience archaïque, poikilos était le terme qui, par excellence, signifiait le monde et l’Etre, un monde aux multiples visages, un monde bigarré et ondoyant, dont les apparences chatoyantes et contradictoires figuraient dans tout leur éclat et leur diversité la vérité de l’Etre. Poikilos est ainsi la plus homérique des épithètes, parce qu’elle signifie un monde où tout est métamorphose, jeu incessant de formes qui se mêlent et nous égarent, parce qu’elle figure un monde qui s’ouvre à l’aventure pour le héros, le polymètis, dont l’intelligence est foncièrement mimétique, polymorphe, capable d’épouser ce chatoiement de l’Etre et de s’en saisir. Platon ne pouvait bien sûr ignorer la façon dont poikilos était le terme qui signifiait, de la façon la plus vive, le visage et la vérité du monde pour toute la pensée archaïque. En reversant et en enfermant ce chatoiement dans une sensibilité excitable et puérile, il est clair qu’il s’agit pour lui de tirer l’Etre hors des apparences instables, de la multiplicité et des contradictions, où cette pensée croyait le poursuivre. La mimesis n’est plus, dès lors, l’attribut remarquable de l’intelligence du monde, d’une mètis aussi mouvante que l’Etre lui-même ; s’y substitue « le caractère réfléchi et serein, toujours égal à lui-même », expressif d’une droite raison, dont « la mesure, le calcul et la pesée » (602d) sont seuls à même d’approcher la vérité d’un Etre, tout aussi égal à lui-même que la raison, un et toujours identique, s’offrant docilement à la règle par sa fixité, sa rectitude et sa permanence. Or, il est remarquable que ce terme de poikilos est précisément celui par lequel Platon caractérise à la fois l’effet de la mimesis tragique, le désordre de la partie sensible de l’âme et celui dont il accuse la démocratie. Ainsi, dans un passage fameux du Livre VIII, il condamne par ce terme le « bazar des constitutions » qu’est selon lui la démocratie : « Comme un manteau bigarré, orné de toutes les couleurs, ce gouvernement bariolé de tous les caractères semblerait être le plus beau » (557e). La démocratie est le régime du chatoiement, des contradictions ondoyantes et séduisantes. Le poikilos qui désignait, pour toute une tradition archaïque, le mouvement même de l’Etre, révélant sa beauté et sa vérité énigmatiques dans le jeu et le foisonnement de ses métamorphoses, se fige ici, sous le regard du philosophe, et n’est plus qu’un assemblage hétéroclite et sans unité. Ce « manteau bigarré » est le parfait contrexemple du bel art poursuivi par le royal tisserand dans le Politique, lui qui cherche à ourdir toutes les différences dans une trame solide, à les entrelacer dans un tissu régulier, au lieu de laisser éclater leurs contrastes et leurs contradictions jusqu’au déchirement. Poikilos cesse alors de désigner la richesse des visages de l’Etre, la façon dont l’Un se révèle glorieusement dans une multiplicité mouvante et contrastée, pour n’être plus que le signe d’un éclatement et d’une dispersion, chaotique et insignifiante. Et Platon d’en tirer la même conclusion qu’à propos des jeux mimétiques : « sans doute cette constitution à l’image des ornements bigarrés qui subjuguent les enfants et les femmes, fait-elle l’admiration du grand nombre ». Aussi les trois critiques que Platon conduit dans la République, la critique de la poésie, de la sensibilité et de la démocratie, ont-elles pour point commun de puiser à une même source, celle de la vérité archaïque. C’est cette source qu’il faut tarir, en réduisant le poikilos à des jeux d’enfants, en niant ainsi qu’il y ait une vérité du sensible, une vérité du multiple, une vérité aussi polyphonique que l’Etre est lui-même polymorphe et contradictoire. En ce sens, l’unité de la réflexion platonicienne se révèle tout entière dans le combat qu’il mène contre l’ontologie archaïque, dont il traque les avatars à la fois esthétiques, psychologiques et politiques.
C’est pourquoi il s’attache tant aux formes du récit du monde dans la République, tout particulièrement aux Livres II et III. Car l’Etre est solidaire du logos, de la parole qui l’énonce. Corriger le récit du monde, c’est aussi transformer l’expérience que nous en faisons. Si Platon entreprend une critique très précise de la poésie homérique et tragique, c’est afin de la purger de toutes les expressions de cette ontologie archaïque, qu’il voudrait faire tomber dans l’oubli, et cela parce qu’il en connaît aussi (et en redoute) les charmes puissants. En effet, il est remarquable que Socrate traque systématiquement dans cette poésie tout ce qui libère les voies du Multiple : polymorphie, polythéisme, polymétis, polyphonie. Ce sont toutes les formes du poikilos qui sont ainsi soumises à critique et dénoncées – non sans nonchalance, d’ailleurs – comme des enfantillages ou des « facilités », peu dignes d’un grand poète tel que Homère. Et cela, essentiellement, parce que chacune de ces expressions (polymorphie, polythéisme, polymètis, polyphonie) figure le devenir incessant de toutes choses, l’ambiguïté des contraires, le jeu et le renversement des valeurs, et enfin la reconnaissance d’une vérité toujours énigmatique. Or, c’est bien ce mouvement qui fait foisonner l’Un en contrastes et contradictions, ce glissement qui renverse le Même dans l’Autre, auxquels Platon veut mettre un terme. Au chatoiement puéril du poète, Socrate oppose ainsi continuellement les lois de l’unité et de la simplicité, qu’il décline en trois règles : unité de l’Etre, unité des caractères, unité du récit. En ce sens, la critique socratique de la poésie homérique n’a une visée pédagogique qu’en apparence : il s’agit surtout de rétablir les droits de l’Etre-Un en réduisant à des contes de bonnes femmes et d’enfants tout ce qui viendrait en contester la règle impérieuse.
C’est pourquoi Platon accorde une place toute particulière à la question des manifestations de la divinité : sa position consiste clairement à purger le divin de la labilité, des contradictions et des ambiguïtés par lesquelles le polythéisme et la poésie l’incarnent. Et s’il y consacre une grande partie du Livre II, c’est bien dans la mesure où il sait à quel point ces manifestations du divin, pour tout Grec, disent le monde et sont le récit de l’Etre. Pour toute une tradition archaïque, la divinité est polymorphe, infiniment mouvante, toujours susceptible de se manifester en des signes contraires ; et ces ambiguïtés ne sont pas des contradictions qui la minent mais plutôt l’expression de sa vérité même, qui se signifie dans la diversité, le chatoiement de ses apparitions. Dieux et héros archaïques ne sont jamais prisonniers d’attributs figés dans la poésie homérique : le temps n’est pas encore venu où le devenir et la fortune seront le signe d’une déchéance pour les dieux et les hommes, déchéance dont on préservera les premiers en les éloignant du monde et qui condamnera les seconds à une errance (romanesque), loin de la reconnaissance et de la fraternité qui unissaient le héros épique et le monde. Si dieux et héros archaïques sont sujets à tant de métamorphoses, s’ils ont des caractères bigarrés, ondoyants et divers, s’ils peuvent se contredire sans se nier, c’est qu’ils sont les éléments d’un monde où tout est action, où l’Etre se dévoile dans un miroitement de signes contrastés sans jamais pour autant se disperser, révélé à lui-même dans l’instant de l’action où fugacement les hommes croisent le regard des dieux. La poésie archaïque nous parle d’un monde où il n’y a pas encore de scission entre la vérité, le savoir et l’action. Or, c’est bien cette scission que la République cherche avant tout à accomplir, la diké platonicienne étant l’harmonie d’un monde figé, où toute chose est à sa place, où l’Etre, toujours égal à lui-même, n’offre plus qu’un seul visage, celui de l’Idée, éternellement fixe sous le regard de l’esprit. C’est pourquoi Socrate se montre si sévère pour tout ce qui, dans la poésie d’Homère, consacre le monde à l’action, à ses revirements et à ses contradictions. Car si dieux et héros se montrent capables de sentiments irascibles et irrationnels, s’ils ne répugnent aucunement à se lamenter, à rire ou bien à verser des larmes, c’est qu’ils sont les uns et les autres emportés dans le mouvement d’une action qui figure la complexité et l’ambiguïté de leurs caractères, aussi mouvants et contradictoires que les occasions qu’ils affrontent. Or, c’est bien cette duplicité des caractères dont Socrate fait le procès dans tout le début du Livre III : comment croire ainsi qu’Achille puisse être double et contradictoire, puisse ainsi, dans l’Iliade, « être affecté de deux maladies contraires, une servilité assortie de cupidité et, à l’opposé, une attitude de mépris envers les dieux et les hommes » (391c) ? Comment croire qu’un si noble héros puisse verser des larmes comme un enfant ou une femme ? Comment croire de même que « Thésée, fils de Poséidon, et Pirithoüs, fils de Zeus, se soient lancés dans ces enlèvements abominables, comme on le rapporte, ni qu’aucun autre enfant de dieu, qu’aucun héros ait eu l’audace d’accomplir des actions aussi abominables et sacrilèges, du genre de celles qu’on leur attribue fallacieusement aujourd’hui » (391d) ? Par-delà la simple critique morale, ce sont deux régimes de vraisemblance qui s’affrontent ici et qui marquent l’opposition entre la parole philosophique et la parole poétique : le récit archaïque est mimesis de la vie et si héros et dieux sont doubles, complexes et incohérents, c’est qu’ils sont de grands vivants (– qu’on nous autorise cet emprunt nietzschéen) ; le récit philosophique, lui, se veut entièrement consacré à la vérité, aux principes d’unité et d’égalité à soi, qui répudient le jeu des contraires. Et l’on retrouve ici, de même que pour la définition de la tragédie au Livre X, un refus de l’entrelacs des contraires, réduit à une alternative sèche, à laquelle Platon veut contraindre la poésie : « Forçons plutôt les poètes à reconnaître ou bien que [les héros] n’ont pas commis de tels actes, ou alors qu’ils ne sont pas les enfants des dieux » (391d). Désormais, la seule vraisemblance possible, la vraisemblance de la logique, que Platon nomme « réalité », doit prescrire le dicible et l’indicible. L’enjeu est tout autant de plier la parole du poète à un principe de vérité, que de subordonner la vie à une logique du réel, qui n’est autre que la réalité de la logique elle-même. Le tour de force de la République est ainsi de faire passer un certain régime de vraisemblance, celui propre à la logique philosophique, pour la norme de toute véridicité.
De même, les métamorphoses des dieux, leurs sautes d’humeur, leurs caractères mouvants et imprévisibles, sont dénoncés au Livre II comme autant de fables puériles. Socrate de s’écrier ainsi : « Et qu’aucun ne vienne, avec ses racontars sur Protée et Thétis, nous présenter dans des tragédies ni d’autres formes de poèmes Héra transformée en prêtresse qui mendie » (381e). Les figures mythiques convoquées ici par Platon ne sont pas choisies au hasard, car Protée et Thétis sont les expressions privilégiées de la métis, de cette intelligence polymorphe qui épouse le mouvement de l’action. Seront donc racontars et mensonges tout ce qui figure le divin dans sa diversité et sa complexité, ce à quoi Platon oppose une vérité, dont les attributs principaux sont l’unité, la simplicité et la négation du devenir : « Le dieu est donc absolument simple, et véridique en actes et en paroles, et il ne se change pas lui-même, pas plus qu’il ne trompe les autres, ni par des illusions, ni par des paroles, ni par l’envoi de signes, que ce soit à l’état de veille ou en rêve » ( 383a).
Cette purgation de l’imaginaire archaïque est prolongée au Livre III par la purgation des formes du discours. S’il s’agit de rechercher une définition de la tragédie par Platon, c’est dans ces pages (392d-394d) qu’on la trouve précisément. Comment la mimesis tragique y est-elle définie ? Essentiellement par la polyphonie, le poète tragique apparaissant comme celui qui jamais ne « parle en son nom propre », son récit s’effaçant au profit de « paroles rapportées ». Or, c’est bien cette polyphonie dans laquelle Platon reconnaît l’effet le plus pernicieux de la poésie tragique, parce que ce récit imitatif, en multipliant les perspectives sur l’action, déjoue tout principe d’unité et de cohérence. L’effet tragique réside selon lui tout entier dans cette façon de disperser l’Etre en dispersant la parole, le poète en rapportant ainsi « un discours particulier comme s’il était quelqu’un d’autre » (393c) condamnant l’action représentée à l’hétérogénéité. C’est pourquoi Platon oppose le dithyrambe à la polyphonie tragique, celui-ci apparaissant comme le modèle même du « récit simple, dépourvu d’imitation » (394b), Socrate payant d’ailleurs d’exemple en proposant une réécriture de tout le début de l’Iliade – le discours épique étant l’intermédiaire entre ces deux discours-, réécriture qui rassemble en un récit unifié tout ce qui était dispersé entre des voix multiples dans l’œuvre d’Homère. Que l’enjeu ne soit pas uniquement poétique mais aussi, et essentiellement, épistémique, la suite du Livre III le confirme : Platon y pose en effet, de façon critique, la question de la compétence des poètes à figurer des savoirs, qu’ils ne font que mimer superficiellement. Autrement dit, s’il dénonce la mimesis tragique, c’est avant tout parce qu’elle met en péril l’unité et la distribution du savoir. Or, il est remarquable que le « récit simple » proposé par Socrate, en lieu et place de l’ouverture de l’Iliade, tend à conjurer tous les hiatus, toutes les contradictions, et la partialité des points de vue, qu’introduit de fait la polyphonie épique ou tragique. L’unité de la parole et de l’action dans un récit simple repousse ainsi l’ambiguïté des voix tragiques, qui, par leur pluralité et parce qu’elles sont plongées dans l’action, ne sont jamais des paroles souveraines, des paroles où le savoir pourrait se faire science. La voix tragique est en effet toujours double et son savoir est frangé d’ignorance. Au terme de L’Antigone de Sophocle, le chœur, qui ne peut ainsi trancher entre les partis qui s’affrontent, conclue : « On a fort bien parlé ici dans les deux sens ». Et si tel est le cas, c’est bien parce que la vérité, dans son expression tragique, n’est jamais contenue dans une parole donnée qui pourrait la tirer au clair et s’en assurer ; elle n’est même pas en partage entre tous les discours mais se situe plutôt dans le silence qui les sépare. Car c’est bien cela que déjoue la polyphonie : l’idée d’une parole-maître, d’un discours où la vérité se dirait tout entière, où elle ne serait pas à rechercher comme l’énigme qui double tous nos savoirs. Par sa simplicité, le récit dithyrambique permet d’évacuer les dissoi logos, les discours doubles, et de figurer l’unité indéfectible de la parole et de l’Etre, en subordonnant l’action au savoir. Il est, en ce sens, le récit le plus conforme à l’exigence philosophique, un récit dont la vérité consiste à dire ce qui est, sans reste et sans ombre.
Tout au long des Livres II et III court ainsi une exigence de véridicité, des dieux, des caractères et du récit, que Platon ne cesse d’affirmer contre la tradition archaïque. Or, c’est une façon pour le philosophe de rejeter dans l’illusion et le mensonge toutes les formes déviées ou biaisées dans lesquelles la pensée archaïque poursuivait le vrai. Insister sur la véridicité, c’est tirer la vérité hors des énigmes, des ambiguïtés et des double sens, dont se nourrit la tragédie. Car il est, au cœur de l’expérience archaïque et tragique, une fondamentale boiterie de l’Etre et de la vérité, boiterie d’un Etre qui se déplie en tours et détours dans l’action et ne se laisse jamais saisir et dire que de façon biaisée ; boiterie de la vérité qui, de même, se livre à la parole autant qu’elle la contredit, qui déjoue le discours qui voudrait la saisir, qui double sa propre clarté et simplicité d’un sens toujours énigmatique ; boiterie qui enfin trouve son achèvement dans la constitution biaisée, bigarrée, de la démocratie, comme le figure Socrate, dénonçant, au Livre VII, les « bâtards » et les « boiteux » de la démocratie, ce qui n’engage pas qu’un mépris généalogique mais tisse un lien symbolique fort entre les formes de la tragédie (comment ne pas y reconnaître en effet une allusion à Œdipe ?) et la déviance politique.
Ainsi, Platon renouvelle continuellement cette opposition entre rectitude et boiterie, opposition qui engage aussi bien l’expression de l’Etre que les formes de discours et qui s’achève dans la distinction des régimes politiques. Car il y a bien un effet politique de la tragédie qui unit selon une même bigarrure, une même façon de troubler l’unité de l’Etre, l’âme sensible, la poésie et la démocratie. Ce lien, Socrate le souligne clairement dans un passage du Livre X : « De la même façon, nous dirons que le poète imitateur instaure dans l’âme individuelle de chacun une constitution politique mauvaise : il flatte la partie de l’âme qui est privée de réflexion, celle qui ne sait pas distinguer le plus grand du plus petit et qui juge que les mêmes choses sont tantôt grandes, tantôt petites, il fabrique artificiellement des simulacres, et il se tient absolument à l’écart du vrai » (605c). Il y a une politique de la poésie parce qu’il y a une poétique de la politique : on ne saurait dès lors comprendre pourquoi la tragédie peut porter en elle une « politique mauvaise » si l’on ne mesure pas que la politique se définit avant tout pour Platon par un certain régime de véridicité, une certaine mimesis. Partant, l’exclusion de la mimesis tragique est peut-être inséparable de la façon dont une autre mimesis, philosophique celle-là, veut la supplanter. Le propos n’est paradoxal que si l’on concède à Platon cela même qu’il cherche à accomplir, c’est-à-dire établir une norme de vérité unique qui s’arroge tous les droits sur la réalité. Il faut bien reconnaître d’ailleurs le triomphe historique à venir de cette « poétique » du vrai, de la raison droite, qui pèse, mesure et calcule, telle que les sciences allaient, par-delà la philosophie, en parachever le mythe. Car si, en apparence, nous n’avons certes pas chassé les poètes de nos Cités, nous ne leur reconnaissons pas vraiment, et guère plus que Platon, le droit de dire le réel et de nous en faire approcher la vérité.
Qu’on nous permette donc, en guise de conclusion, d’hasarder une hypothèse : ce que nous nommons philosophie, et que nous devons à Platon, consiste essentiellement dans cette subordination de toute vraisemblance à une vérité définie par l’identité et l’unité, subordination qui allait par la suite décider exclusivement de la séparation entre l’ordre de la réalité et tout ce qui serait rejeté dans le domaine de l’imagination, de l’illusion, de la fantaisie poétique. Parce qu’en effet nous sommes les héritiers en droite ligne de Platon, parce que nous admettons comme une évidence que l’art peut être jugé à l’aune d’un principe de vérité qui subordonne la vraisemblance à la réalité, une réalité tout entière prescrite par la logique platonicienne, nous forçons nous-mêmes les poètes à respecter cette unité, cette identité à soi et cette cohérence, cette logique à laquelle nous donnons le nom de « réalité ». Et quand ils ne le font pas, nous les excluons de notre Cité, de la Cité de la vérité, pour les laisser errer hors les murs, dans des mondes imaginaires, où nous les rejoignons parfois, lassés que nous sommes de nous en tenir toujours à cette réalité.
La République a ainsi décidé de notre histoire parce qu’elle a subordonné la vie à la logique du vrai, tel que désormais le destin de sens de toute parole est de se conformer à cette véridicité logique. Et ce ne sont pas simplement les poètes que Platon veut contraindre à cette conversion : c’est la vie elle-même qui, intégralement, est sommée d’apparaître ainsi, de se conformer à cette vraisemblance logique qui se donne le nom de « réalité ».
Si donc la critique platonicienne de la tragédie, a fortiori son exclusion, peut nous apparaître aujourd’hui embarrassante et déconcertante, c’est parce que la poésie est dépouillée pour nous de toute charge ontologique - ce qu’elle n’était pas encore pour Platon. Les traits les plus caractéristiques de notre rationalité sont en effet ceux-là mêmes que le philosophe opposait à l’art tragique : unité, simplicité, égalité à soi de l’Etre et de la vérité, partition de la raison et de la sensibilité, de la réalité et de l’illusion, primat enfin du savoir sur l’action. De toute évidence, nous n’ignorons pas le tragique. Mais nous ignorons tout de la tragédie. L’Etre a cessé de chatoyer, de nous troubler par ses énigmes. Nous avançons sans craindre de boiter, de nous découvrir soudain monstres et merveilles. Nous avançons.
(27- 06- 2017)
La pierre et l'arc - l'unité poétique du monde.
« Marco Polo décrit un pont, pierre par pierre.
- Mais laquelle est la pierre qui soutient le pont ? demande Kublai Khan.
- Le pont n’est pas soutenu par telle ou telle pierre, répond Marco, mais par la ligne de l’arc qu’à elles toutes elles forment.
Kublai Khan reste silencieux, il réfléchit. Puis il ajoute :
- Pourquoi me parles-tu des pierres ? C’est l’arc seul qui m’intéresse.
Polo répond :
- Sans pierres il n’y a pas d’arc. »
Italo Calvino, Les villes invisibles
Dans ce passage des Villes invisibles d’Italo Calvino, le voyageur, Marco Polo, et l’empereur, Kublai Khan, s’entretiennent de l’Etre des choses, de ce qui fait que les choses sont ce qu’elles sont. Le grand Empereur voudrait des choses percer le secret, savoir quel est leur principe, pour mieux les connaître et les saisir. Ainsi, est-ce la matière qui fait qu’une chose est ce qu’elle est ? Puis-je atteindre la totalité d’une chose par les éléments qui la constituent ? Un pont est-il la somme de ses pierres ? Est-ce que j’aurais exprimé le pont quand je l’aurais décrit pierre par pierre ? Mais dans quelle pierre chercher l’arc qui donne sa consistance au pont ? Aussi loin que l’on puisse s’enfoncer dans la matière d’une chose, en analysant les éléments qui la composent, l’aura-t-on saisi ainsi dans sa singularité ? Car le pont est dans toutes ses pierres et il n’est dans aucune d’elles : il est tout en pierre mais le tout n’est pas de pierre ; le pont est fait de pierres mais des pierres assemblées ne suffisent pas à faire un pont. Il ait en chaque chose une forme qui éclaire leur Etre et que la matière n’exprime pas.
Quoi de plus accidentelle, dès lors, que la pâte dont les choses sont faites ? N’est-ce pas dans la « ligne », dans la forme, que se loge le secret des choses ? Le pont n’est-il pas dans l’Idée, dont aucune pierre n’est le principe ? Mais un pont sans les pierres qui le font être est-il encore un pont ou l’idée d’un pont ? Et n’aurais-je d’un pont que l’idée, puis-je rêver de l’arc d’un pont sans les pierres qui composent sa ligne ?
Kublai Khan est un empereur et, comme tout empereur, il veut tenir un monde entre ses mains : il veut savoir ce que sont les choses et ce par quoi elles sont ce qu’elles sont, trouver le principe où se loge le secret de l’Etre, le principe qui soutient toutes choses. Kublai Khan est un métaphysicien : il veut saisir l’Etre véritable (l’ontôs on) au cœur de l’existence. Mais la vérité est tout autre, poétique. On ne peut séparer la forme et la matière au gré de nos hiérarchies principielles. De la pierre au pont, du pont à l’arc, de l’arc à la pierre : la vérité de l’Etre n’est pas celle d’une ligne qu’on divise ; l’existence a la grâce d’un arc. Ni essence, ni cause première ; l’arc est de pierre, la pierre est pierre de l’arc, et la poésie rejoint la poésie, le cercle de l’Etre parménidien. « Où que je commence, cela m’est indifférent, car je retournerai à ce point à nouveau » (Fragment V) : vérité poétique, vérité sensible dont seule peut s’élever « le déploiement réunifié du monde en son évidente vraisemblance » (Fragment VIII).
(08-2018)
Deux Œdipe et notre histoire –
Parmi tous les mythes, celui d’Œdipe a sans doute le pouvoir, plus que tout autre, de réfléchir notre histoire, d’interroger la part de savoir et d’ignorance, qui creuse chaque représentation de l’homme. Peut-être parce que ce mythe nous place devant l’énigme de notre regard, devant l’ambiguïté du visible, de l’évidence, de notre clairvoyance et de nos certitudes. Il est le plein midi d’une lumière aveuglante, d’une vérité qui crève les yeux et ne nous les ouvre qu’à ce prix. En ce sens, Œdipe nous fait toucher l’essence de la tragédie, cette ambiguïté qui unit le savoir et l’ignorance, qui mêle la clairvoyance et l’aveuglement et les renverse dans leurs contradictions. La conscience tragique converge tout entière vers ce point où l’homme s’éveille au trouble, à la duplicité des valeurs qui fondent son expérience, où il se révèle à la fois merveille et monstre, condamné à une ambiguïté qu’aucune dialectique ne peut trancher. Ainsi, bien loin d’être une de ces formes iconiques parmi d’autres au travers desquelles peuples et cultures se donnent une figure historique et cherchent à laisser une trace triomphante d’eux-mêmes, ce mythe nous conduit toujours à la limite ou sur le seuil, comme l’on voudra, où l’homme affronte l’énigme de son être et s’y arrête. Car c’est là le procès de toute ontologie qui surgit du tragique : nul savoir ne peut subsumer notre ignorance, nulle conscience tragique, aussi loin qu’elle veuille donner voix au désespoir ou à l’angoisse pour qu’ils se transforment en un savoir de l’homme, ne peut faire que l’ignorance se change en savoir de l’ignorance, que notre aveuglement se mue en lucidité.
Comme nous l’avons montré ailleurs, la philosophie s’est inaugurée par la décision d’en finir avec cet « archaïsme », afin de donner place au savoir et à la vérité, une vérité libérée de toute ambiguïté tragique. La valeur de commencement que nous attribuons à cette forme de pensée, reconnaissant dans la philosophie une sorte de baptême de notre vision du monde, déclare le caractère décisif qu’elle a pu avoir dans la constitution à venir des savoirs et de leurs vérités mais aussi, à la manière d’un lapsus, la façon dont cette décision s’est affirmée au prix de l’oubli, du refoulement du sens tragique de la vérité et de l’énigme qu’est l’homme. C’est pourquoi Œdipe n’est pas un mythe mais le miroir qui réfléchit le plus exactement notre histoire. Comme Œdipe devant la Sphynge, nous croyons triompher de l’énigme en répondant « l’Homme », sans entendre que cet homme, c’est nous, sans mesurer qu’en chacun de nos savoirs se loge encore un aveuglement têtu sur nous-mêmes, que notre clairvoyance se double de l’aveuglement qui la nourrit.
Comme l’a montré remarquablement Jean-Pierre Vernant, l’ambiguïté tragique d’Œdipe est en effet tout entière rassemblée dans la clairvoyance et l’aveuglement de la réponse qu’il apporte à l’énigme du monstre : il dit « l’Homme » mais il n’entend pas, dans la question même que lui pose la Sphynge, que cet homme, c’est lui ; au cœur de sa réponse exacte, il ignore le sens de ce qu’il dit. Œdipe face à la Sphynge, c’est le philosophe et tous les hommes de science à venir qui répondent clairement et distinctement : « l’Homme », sans mesurer que cette réponse exacte qui précipite la chute du monstre, ne triomphe de l’énigme qu’en apparence, que le savoir de l’Homme se double de l’ignorance de nous-mêmes, que cette ignorance est l’effet même de ce savoir qui croit la subsumer. Aussi l’énigme ne sombre-t-elle pas avec le monstre qui la proféra : elle nous échoit désormais, nous sommes l’énigme, et, comme Œdipe, nous l’ignorons au moment même où nous nous affirmons savants et du fait même que nous nous affirmons tel. Dans la Krisis, Husserl montre génialement à quel point l’exactitude des sciences objectives modernes s’est affirmée au prix d’un enfouissement de l’esprit, s’égarant au cœur même du triomphe de son objectivité et devenant toujours plus obscur à lui-même, perdu dans le labyrinthe de ses propres œuvres. Mais cette « crise » a pris forme bien avant la révolution galiléenne : elle est notre histoire, l’avènement d’un logos souverain fondé sur l’ignorance de l’énigme tragique, d’une vérité qui crève les yeux.
Que nous soyons « oedipiens », en un sens qui non seulement échappe à l’analyse freudienne mais dont elle tend à accentuer le refoulement, qu’Œdipe ait la dignité et la force d’un mythe des origines, non simplement parce qu’il signe une provenance mais éclaire et devance notre histoire, les œuvres picturales en sont les témoins remarquables en tant qu’elles rejoignent avec ce mythe le seuil de leur propre énigme, la monstration, quand ce qui se donne à voir déclare aussi les limites de la représentation, quand le regard affronte l’évidence aveuglante du visible.
Mais parmi les très nombreuses représentations du mythe d’Œdipe dans l’histoire de la peinture, deux œuvres ont, de façon évidente, un statut singulier en raison du dialogue qui s’instaure entre elles. Il s’agit de la toile d’Ingres, Œdipe et le sphinx (1808) et de celle de Francis Bacon, Œdipe et le sphinx après Ingres (1983), Bacon soulignant une dette et un héritage, l’inscription dans une tradition, par le titre même qu’il donne à son œuvre. C’est pourquoi d’ailleurs ce titre joue un rôle décisif dans la façon de voir et d’interpréter cette œuvre, quand, la plupart du temps, – et c’est le cas du titre de la toile d’Ingres, les titres, non seulement ne sont pas le fait du peintre, mais ne font que redoubler l’évidence de l’objet représenté. Ainsi, Bacon aurait très bien pu, selon l’usage, nommer son œuvre, Œdipe et le sphinx, comme le firent Ingres et bien d’autres avant lui et après lui, ou bien encore en laisser le soin aux historiens de l’art. Or, ce faisant, il oriente délibérément le regard du spectateur, le conviant à interroger le dialogue qui s’instaure entre les deux œuvres, tirant la représentation d’Ingres de son solipsisme, pour en faire l’élément d’un diptyque ou, plus encore, pour signifier que cette toile est la matière première que veut travailler le peintre. Palimpseste donc, ce qui change complètement le regard que l’on peut porter sur cette œuvre : car ce n’est plus alors une nouvelle image d’Œdipe et le sphinx que nous propose le peintre, mais une œuvre qui interroge la représentation que nous nous sommes fait du mythe ; ce n’est pas tant « Œdipe et le sphinx » que nous donne à voir Bacon, c’est notre regard sur le mythe qu’il veut interroger.
On sait à quel point cette façon d’inscrire ses œuvres dans l’histoire de la peinture et de les déclarer ainsi comme des sortes de palimpsestes lui est familière, qu’il s’agisse des reprises du portrait du pape Innocent X de Velasquez ou bien encore les Six études d’après l’autoportrait détruit de Van Gogh. Toutefois, situer l’œuvre dans une tradition prend un sens décisif chez Bacon : par-delà le simple hommage ou la reconnaissance d’une dette, il s’agit pour le peintre de figurer le travail de l’histoire, la façon dont les images se métamorphosent, se déforment, se décomposent, au gré d’un devenir dont elles portent les stigmates. En ce sens, Bacon ne peint pas « à la manière de », d’après ; il ne renouvelle pas l’image pour lui conférer la vierge immobilité de l’éternel, mais la livre au contraire à la corruption du temps, à la violence de l’histoire. Aussi Œdipe et le sphinx après Ingres peut-il apparaître comme le paradigme de toute son œuvre, car Bacon peint toujours après, non pour restaurer une origine et biffer le temps, mais pour signifier le destin des images, la façon dont l’histoire les dévastent selon un destin qui ne leur est nullement extérieur mais qu’elles portent en elles et qui en font les vivants témoins de ses outrages. Les œuvres de Bacon, par le dialogue qu’elles instaurent avec leur glorieux parangon, semblent en effet intérioriser le devenir entropique qui les affectent, faire face à leur propre désastre. Qu’il s’agisse en effet du portrait classique, de l’autoportrait ou d’Œdipe, chaque forme garde toujours en elle la lointaine conformité à son modèle comme s’il s’agissait de rendre plus sensible encore l’énigme de leur métamorphose monstrueuse.
Peindre après, c’est ainsi exposer les images à l’alchimie aveugle et imprévisible du temps et de l’histoire, qui effacent les lignes, disloquent les formes, boursouflent ou tronquent les corps, puis les abandonnent, seuls, face à cette incongruité que la banalité de la scène ou son référent classique rendent encore plus sensibles. Il s’est passé quelque chose. Les images ont perdu avec Bacon leur statut divin de représentation qui, pour être le miroir de notre histoire, n’en seraient pourtant jamais affectées ; elles ont un destin désormais, elles partagent le destin des mortels, leur déchéance, elles ont une chair qui les exposent aux vicissitudes du devenir. C’est le temps, c’est l’histoire, qui font grimacer l’innocent. Il y a de la foire chez Bacon, foire aux Freaks, aux estropiés, aux éclopés, mais quand le rideau se lève sur ces grotesques, chacune de ces images nous met face à l’énigme du destin auquel nous les avons exposés, notre destin, notre histoire. Livré à toutes les métamorphoses d’une matière en perpétuel mouvement, le corps devient alors une « Force sans objet », pour reprendre une expression de Deleuze : on ne peut plus arrêter les évolutions et les involutions de la matière, les contenir dans une figure qui ferait signe et qui ferait sens. L’image a pris vie et elle subit la puissance absurde de l’existence. Dans un entretien, Bacon disait : « je crois que l’homme aujourd’hui réalise qu’il est un accident, que son existence est futile et qu’il a joué un jeu insensé ». C’est à cette conscience que les œuvres du peintre veulent sans doute nous conduire mais elles le réalisent non par la simple représentation du non-sens mais par son intériorisation ; Bacon ne figure pas le non-sens, il soumet les formes au non-sens, celles-ci devenant les témoins de ce « jeu insensé » qui les saisit, de cette énigme qui leur échappe. Le jeu de la représentation se poursuit en apparence : par bien des aspects, Bacon est un peintre classique par ses portraits, ses scènes de genre, ses nus ou bien encore ses natures mortes. L’incongruité des corps s’impose d’ailleurs d’autant plus au spectateur qu’elle s’accompagne de signes familiers voire triviaux, figurés avec un réalisme plat : des intérieurs modernes, peuplés d’objets domestiques (table de salon, chaise, cendrier, lit, toilette, etc.) ; les murs sont ripolinés, ampoules et interrupteurs occupent souvent le centre de la toile ; des messieurs en costume prennent la pose. Normalité du « cadre » qui fait d’autant plus saillir le jeu des corps qui se délitent, se contorsionnent, dansent au gré d’une spontanéité mystérieuse, des corps sans propriété, sans sujet. Tous les corps chez Bacon sont des sphinx. Et ils nous opposent une énigme qu’on ne peut pas résoudre. La vie, insoumise, déborde le sens, bave hors des lignes, exprime en défigurant, en désarticulant les proportions, les harmonies, l’ordre du visible. On ne peut même pas parler de langage du corps, car les corps chez Bacon, obstinément, se refuse à devenir des signes. Il n’y a pas d’image dans le tapis, comme pour le cubisme, pas de perspective qui mettrait de l’ordre dans ce chaos, comme dans les anamorphoses. Les involutions primitives, fantastiques, de ces corps ne se résolvent pas en une signification ; nous assistons à une danse pure, archaïque, tel que la définissait Paul Valéry : ces corps, comme la danse valérienne, ne vont nulle part. Et c’est pourquoi les lieux du sens, le visage et le regard, qui sont les lieux de la certitude, de la forme, de l’Idée, sont livrés au devenir d’une matière dont le mystère les dépasse. Quand les yeux sont encore ouverts, dans les autoportraits, le regard n’en a pas moins perdu sa souveraineté, son pouvoir de retenir, de contenir et d’unifier. Il cesse d’être l’opérateur de la reconnaissance et semble accuser l’incongruité d’un corps qu’il ne possède pas. Si Bacon admirait tant Rembrandt, c’est sans doute parce qu’il retrouvait dans les autoportraits du maître ce conflit entre la permanence, la fixité du regard et le devenir incongru, la déliquescence énigmatique du corps. Au fil de son œuvre, Bacon se détourne peu à peu des visages et du regard. Les yeux se ferment, les personnages sont vus de dos. Droit à la chair : il n’y a plus de centre, d’ordre, de hiérarchie organique, pour dénoncer ou contredire la plasticité de la vie, dont les mouvements ouvrent désormais sur une expressivité sans limite. Et ce jusqu’à l’évincement du visage, où c’est la vie qui semble imiter l’art, dans une sorte de régression à l’antique, aux bustes archaïques (Study of the human body from a drawing by Ingres et Study of the human body, 1982), où la chair semble désormais inventer continûment les principes de son expression en détournant les codes de la représentation. Jusqu’à la dissolution du corps qui rejoint la matière pure, poussière ou sable, ou plutôt leur fusion, le corps se faisant dune et la dune figurant toujours le corps (Sand dune, 1981).
Qui fait face à une toile de Bacon est saisi par le sentiment d’assister à un mystère, la violence de l’expression se doublant d’une solennité quasi rituelle, mais un rite dont le sens a été perdu et qui n’offre plus au regard que son expression pure, archaïque. Ce faisant, ce n’est pas une foire aux monstres à laquelle nous sommes conviés, comme nous le supposions, mais à une scène sacrificielle, à la scène tragique originelle. Sur l’autel du dieu de folie, Bacon dépose l’image de l’homme, la livrant au non-sens du devenir et de l’histoire, lui conférant ainsi le destin des mortels pour qu’éclate l’énigme irrésolue : la vie. Le peintre laisse dériver l’image, la livre au hasard d’une entropie, auquel il s’abandonne bien plus qu’il ne la commande, pour que, de ce « jeu insensé » de la matière, surgisse soudain le « jeu insensé » de notre subjectivité, de nos pouvoirs et de nos savoirs. Remarquable est ici l’usage de plus en plus fréquent dans ses dernières œuvres de symboles autoritaires de signification : des flèches rouges, des cercles analytiques, ordonnent le regard et semblent répondre à son désir de sens. Mais, ironie envers ce désir ou mélancolie face à son dérisoire entêtement, ces signes pointent le rien ou l’effacement, le phantasme d’un sens insaisissable déposé sur des lettres illisibles. Aucun savoir ne peut subsumer le visible. Le monde n’est pas un livre. Le sens rature le visible. Le cri d’Innocent, c’est l’inouï du visible, de ce nous croyons voir parce que nous croyons le savoir. Là est notre non-sens et notre énigme, ce « jeu insensé » qui exprime notre impossibilité à être : nous croyons savoir ce que nous voyons parce que nous croyons voir ce que nous savons. Les corps, disions-nous, sont des sphinx dans l’œuvre de Bacon. Et nous, qui regardons ces œuvres, nous sommes Œdipe, celui qui sait, celui qui boîte, celui qui boîte parce qu’il croit savoir, avide de signes, qui veut voir et savoir, sans comprendre que le savoir crève les yeux, que tout savoir se double d’un aveuglement. Que Bacon ait insisté pour que ces toiles soient exposées dans des cadres surchargées de dorures, comme des chefs d’œuvre classiques et recouvertes de vitres qui, immanquablement, en parasitent la visibilité, en réfléchissant comme des miroirs la lumière et l’espace alentour, ainsi que la présence des spectateurs, est particulièrement révélateur. L’écrin doré commémore l’idole, le sacre de l’art. Or, par un jeu de tensions et de violentes contradictions, Bacon nous met face au crépuscule des idoles, au double sens du mot dans la langue allemande, que Nietzsche n’ignorait pas : l’assombrissement, l’extinction, mais aussi l’aube, l’avènement d’une autre présence. Et c’est en ce point ambigu que se situe précisément son art, où le délitement des formes, des figures, de l’ordre et des significations classiques, ne se résout pas en une pure désolation, mais au contraire ouvre pour la matière le champ d’une expressivité inédite, fruit d’une vitalité retrouvée, libérée des codes de la représentation. Et c’est ce qui sans doute fait de Bacon le peintre le plus classique de la modernité, qui nous conduit au point d’achèvement des images, pour nous faire les témoins de ce sacrifice et de cette aube.
Quant au choix d’exposer ces toiles sous des vitres réfléchissantes, il produit, sur le plan de l’espace visible, une tension analogue à celle du cadre sur le plan historique et temporel. En effet, cette vitre miroir rapproche le spectateur de l’image et à la fois l’en éloigne. Réfléchi, le témoin est absorbé par l’image, le voyant participe du visible, et il faudrait montrer – mais ce n’est pas notre objet ici – comment cette inclusion est tramée dans les œuvres de Bacon, l’artifice de la vitre ne faisant qu’en redoubler l’effet. Il y a, en ce sens, une logique puissamment théâtrale dans sa création : de même que le texte dramaturgique tend à produire au-delà de l’espace scénique un espace de visibilité, qui inclut les témoins dans le drame, de même chez Bacon, le visible traque le voyant et le tire de sa souveraine invisibilité. On ne peut être le simple spectateur d’un sacrifice ; le voyant est un officiant. Et ce reflet n’est pas sans brouiller les rôles : Qui est le voyant ? Qui est l’image ? Nous sommes embarqués, le voyeur est démasqué. Il ne s’agit plus d’un spectacle, d’une contemplation innocente, mais d’un face à face, où ce n’est plus simplement l’image qui est exposée à notre regard mais nous qui sommes interpellés, sommés d’affronter l’énigme qu’elle nous oppose. Toutes les images chez Bacon sont des sphinx. Et nous ne sommes pas, nous ne sommes plus, les souverains déchiffreurs de nos images. Images nous-mêmes, nous sommes embarqués dans l’énigme, cherchant désespérément le point où nous cesserons de nous voir, où nous pourrons fuir notre propre reflet. Le jeu insensé, c’est de croire que nous pouvons déchiffrer les énigmes, que nous savons voir. L’énigme, c’est notre image, c’est notre histoire. Que pourrait être une vision qui serait vision d’elle-même, demande Socrate, dans le Charmide, face à l’énigme delphique du « connais-toi toi-même » ? C’est une image, une image qui, soudain, nous regarde. Et ce renversement ne lève pas l’énigme, il la creuse. Face à une toile de Bacon, nous voudrions fuir, mais il est trop tard : nous sommes compris.
Mais ce miroir qui nous absorbe parasite en même temps l’image et nous en interdit l’accès. On ne sait pas où se mettre. On cherche désespérément l’endroit, la perspective, où l’on pourra échapper à soi-même, voir sans se voir. Cette incommodité, loin d’être anecdotique, est révélatrice de la façon dont le peintre cherche à bousculer l’évidence du regard : l’image se dérobe sans cesse et l’on ne peut plus la saisir comme une totalité asservie à la vision, au spectacle. Le témoin est contraint au mouvement pour échapper à la réflexion ; son regard est tiré de l’idolocentrisme qui assure habituellement sa souveraineté sur le visible, sur ce qui est fait pour être vu. S’opère ici une autre révolution copernicienne : ce n’est plus l’image qui vient à nous, apprêtée pour notre regard ; nous tournons autour d’elle, nous cherchons sans le trouver l’endroit où l’image se livrera tout entière. L’énigme requiert le labyrinthe et Bacon excelle dans l’art des fausses pistes, des trappes, des chemins qui ne mènent nulle part. En contrariant ainsi notre intentionnalité, Bacon brise le lien de la vision et du savoir, le lien qui voudrait que le visible se donne dans l’unité d’une forme-sens immédiatement saisie et reconnue. Or, ce dispositif ne fait que redoubler la façon dont il ne cesse de déjouer les attentes du regard dans ses œuvres, de lui tendre des pièges et de se jouer de nos fascinations. Ce jeu de dupe est particulièrement sensible dans l’usage qu’il fait des marques du sens, flèches ou cercles, dans ces dernières œuvres. Soit en effet ces indices conjurent les effets de sens et de fascination en les anticipant – un sexe est entouré d’un cercle, façon de surenchérir sur la mécanique prévisible de nos centres d’intérêt et de nos interprétations – soit ils déconcertent notre volonté de savoir, de comprendre, de refermer notre regard sur une signification – une flèche pointe le rien, l’indicible, l’infini, et met au défi notre insatiable désir de sens.
Je ne suis pas spécialiste de l’œuvre de Bacon. Il s’est agi auparavant de mettre en évidence quelques indices capables de rendre probants l’interprétation selon laquelle l’énigme et le Sphinx jouent un rôle décisif dans l’imaginaire du peintre, indices qui pourraient nous autoriser à reconnaître dans Œdipe et le Sphinx après Ingres une oeuvre où convergent toutes les forces et les contradictions disséminées ailleurs.
Comme nous l’avons souligné, un des traits remarquables du travail de Bacon est d’inscrire son œuvre dans un rapport de tension avec l’histoire de la peinture et, par-delà, avec notre histoire. Palimpsestes, ses œuvres exposent les icônes du passé au devenir pour interroger, au travers de leurs métamorphoses, notre destin. En ce sens, on ne saurait les approcher sans tenir compte du dialogue qu’elles instaurent avec leur paradigme, telle que cette relation ne se réduit pas à l’imitation d’un modèle : peindre après Ingres, ce n’est pas revenir à Ingres comme à une origine, c’est se demander comment le temps et l’histoire affectent nos icônes. Le peintre est cela : le témoin du passage du temps, d’un devenir qui déforme les images. Et il ne s’agit aucunement d’une déformation réglée, en vue de l’apparition d’une nouvelle icône, qui trouverait son point d’arrêt dans une forme inédite, une image pour notre modernité. L’image est image-temps chez Bacon, mais elle n’est pas une image du temps, elle le subit elle-même, et ce devenir ne livre pas ses raisons. Car il ne suffit pas de peindre la douleur, le non-sens, l’entropie, la folie, pour les rendre sensible, il faut y sacrifier les images elles-mêmes. Bacon peint la souffrance de nos icônes.
Œdipe le sphinx. L’œuvre du peintre Auguste-Dominique Ingres fut initialement réalisée en 1808, puis reprise en 1827. On lui adjoint parfois un autre titre, intéressant, savoureux et terrible par sa franchise : Œdipe explique l’énigme au Sphinx. Qu’importe son caractère apocryphe ou non, ce dernier titre exprime parfaitement le sens de l’œuvre. En effet, ce que l’on voit est exactement cela : ce n’est pas le Sphinx qui expose Œdipe à l’énigme, à son destin tragique, c’est bien Œdipe qui explique l’énigme au Sphinx.
Cette
œuvre est tout entière construite autour du double geste du héros
qui en occupe le centre et captive le regard : la main qui
résout l’énigme et celle qui, symétriquement, l’élucide.
C’est évidemment cette interprétation qui motive le titre car
Œdipe est bel et bien en train de répondre à l’énigme de la
Sphynge, comme le signifie la main qui est tournée vers lui, et de
lui donner l’explication de sa réponse, comme le suppose la main
qui est pointée vers le monstre. Or, ce geste, qui concentre ici à
lui seul tout l’héroïsme d’Œdipe, a une portée symbolique qui
dépasse cette interprétation littérale. Par lui, Œdipe n’est
plus simplement en effet consacré comme le déchiffreur d’énigmes :
reprenant l’énigme, il s’en empare désormais au lieu de la
subir ; il affirme son pouvoir de s’exposer à des questions
qu’il se donne lui-même et qu’il appartient à lui seul
d’énoncer. Le triomphe du héros consiste ainsi dans cette
confiscation du logos,
dans cette affirmation d’une Raison souveraine, qui oppose au
monstre la monstration et qui fait de l’énigme son problème.
le signifie la main qui est tournée vers lui, et de
lui donner l’explication de sa réponse, comme le suppose la main
qui est pointée vers le monstre. Or, ce geste, qui concentre ici à
lui seul tout l’héroïsme d’Œdipe, a une portée symbolique qui
dépasse cette interprétation littérale. Par lui, Œdipe n’est
plus simplement en effet consacré comme le déchiffreur d’énigmes :
reprenant l’énigme, il s’en empare désormais au lieu de la
subir ; il affirme son pouvoir de s’exposer à des questions
qu’il se donne lui-même et qu’il appartient à lui seul
d’énoncer. Le triomphe du héros consiste ainsi dans cette
confiscation du logos,
dans cette affirmation d’une Raison souveraine, qui oppose au
monstre la monstration et qui fait de l’énigme son problème.
Dans l’image, l’énigme ne semble jamais avoir appartenu à la Sphynge ; l’eût-elle proférée auparavant, elle appartenait déjà à Œdipe, à son pouvoir d’expliquer. Le geste apparaît dès lors des plus ambigus. Les rôles se sont semblent-ils inversés, car Œdipe se contente-t-il ici de résoudre l’énigme ou n’est-il pas plutôt lui-même en train de soumettre le monstre à la question ? C’est pourquoi d’ailleurs le geste qui semble interroger la Sphynge, la désignant pour mieux la déposséder de son énigme, est bien plus souligné, concentrant toute l’audace de cet Œdipe, qui ne craint pas de frôler avec témérité la patte du monstre, quand le geste qui signifie la réponse, lui, est d’une grâce presque nonchalante. Pouvoir de montrer, de dire et d’expliquer : c’est ce geste qui dans la toile fait la lumière, qui consacre l’homme, au travers d’Œdipe, comme l’animal rationale dont le pouvoir consiste dans cette faculté de désigner toutes choses, de l’amener à la lumière en l’expliquant et qui, ce faisant, peut déjà effacer le monstre en l’approchant. Car, par ce geste de triomphe, ce héros si éclatant, dont la parole souveraine est capable à la fois de d’interroger et de répondre, et qui ne résout que ses propres questions, affirme que sa parole et sa raison, seules, pourront justement faire la part entre les ténèbres et la lumière. Tout se passe en effet symboliquement comme si c’était le geste de monstration d’Œdipe qui communiquait au monstre une part de la lumière qu’il concentre jalousement, comme si le pouvoir d’Œdipe était ici de pouvoir faire choix de ce qu’il amènera par sa parole à la lumière et de ce qu’inversement il consacrera aux ténèbres, à l’oubli ou à l’ignorance.
Héros de la lumière que cet Œdipe, héros des Lumières. Et déjà le visage de la Sphynge disparaît, le visage des dieux, des monstres, d’une nature énigmatique et démonique, parlante dans tous les cas, capable de nous étonner et de nous faire signe. Déjà, son visage obscurci a la rigidité de la pierre, l’inactuelle fixité des bustes antiques. Elle a croisé le regard de Méduse de la raison nouvelle. Et il ne reste plus que ce corps familier, banal, du désir, dont la monstruosité même s’estompe et rejoint les ténèbres des légendes et des mythes.
C’est donc cela expliquer l’énigme au Sphinx : c’est transformer les énigmes en problèmes, réduire le face-à-face avec le monstre, avec une nature tragique, à une relation d’objectivation qui supprime toute altérité, qui dénie surtout à cette nature le pouvoir de proférer une parole que la raison ne pourrait pas reprendre, dans laquelle elle ne pourrait pas se retrouver elle-même. Le héros tragique est devenu le sujet moderne, le sujet souverain et législateur, qui, par son pouvoir de monstration, peut transformer toutes choses en son objet. Une « révolution copernicienne » est passée par là. Cet Œdipe-ci semble avoir appris de Descartes et de Galilée que l’on peut déchiffrer entièrement le livre de la nature, que l’homme peut désormais tout expliquer et cesser de trembler en vain devant les phénomènes. Il a appris de Kant que la raison ne doit pas se soumettre à la nature comme un élève mais qu’elle doit au contraire la plier à sa législation et la contraindre à répondre à ses questions comme un juge. Car elle est jugée, cette Sphynge, et c’est bien à une espèce d’interpellation que la destine le doigt accusateur du héros, qui la dévoile avec impudeur. Voilà le nouveau soleil resplendissant, le sujet, autour duquel la nature entière tourne docilement. Ce doigt qui montre, qui explique et qui éclaire, sera un levier d’Archimède, capable de faire la part entre les chimères de l’imagination et les faits mesurables.
La dissymétrie des nudités dans l’image est sur ce point significative. Le corps d’Œdipe rassemble tous les modèles de l’héroïsme antique, réinterprété par le néo-classicisme : un corps non pas nu mais qui est en quelque sorte habillé de sa nudité symbolique, un corps-idée, symbole d’une virilité asexuée, citoyenne comme chez David, et qui incarne avant tout la volonté pure. Le corps de la Sphynge est au contraire partagé, divisé, miné par l’ombre qui la gagne peu à peu comme une lèpre. Le jeu de la lumière souligne à quel point ce corps est un patchwork absurde où se mêlent des morceaux hétéroclites d’idéaux antiques, de précisions zoologiques et de fantasmes érotiques. Or, ces contrastes, loin de figurer la monstruosité effrayante de la Sphynge, soulignent plutôt la bizarrerie de sa composition et révèlent à quel point elle n’est qu’un bricolage foutraque d’éléments impossibles. Ce n’est donc pas le monstre qui surgit ici de la nuit pour troubler notre regard et faire vaciller nos certitudes : c’est l’aube d’un homme solaire qui rejette vers les pesanteurs nocturnes les chimères anciennes. L’énigme est démystifiée. Sous la lumière crue de la raison, ne demeure plus que le corps du désir et ces protubérances obscènes, destinées à l’analyse mécaniste, physiologique, psychologique. Nous ne sommes pas encore à la Salpêtrière mais la science a depuis longtemps trouvé son objet de prédilection, son principe de raison, le désir, qui est à la fois la matrice de toutes les extravagances et ce qui permet de les rationaliser. Il est là le monstre de foire, pointé de façon obscène par Œdipe, qui, d’un geste, met à nu le mythe, la poésie, la tragédie, toutes les fables antiques. Car, à bien y prendre garde, on peut se demander si, dans cette image, le regard de la Sphynge est vraiment terrifiant ou plutôt horrifié d’être dévoilé avec tant d’impudeur. Nous croyons voir rougir le monstre. La patte qui se tend est-elle si menaçante que cela ? Cela semble plutôt un geste de supplique, somme toute timide, comparé à l’attitude conquérante, intrusive, du héros.
Du nom d’Œdipe, ne demeure ainsi dans l’image que le savoir glorieux. Il est celui qui sait, absolument, et ce savoir est pure lumière, libérée des ombres et des fantômes du passé. Corps glorieux d’un savoir glorieux, il ne porte aucunement les stigmates de sa généalogie. De sa boiterie, en effet, il ne demeure rien. L’Œdipe d’Ingres est guéri de toute ambiguïté tragique et on cherchera vainement dans l’image les indices de son destin. Et cela, parce que sa temporalité n’est pas le passé, un passé que l’on fuirait et qui nous poursuivrait. Ingres fut l’élève de David et, à l’instar de son maître, le néoclassicisme qui imprègne son œuvre ne consiste pas à s’inscrire dans une tradition historique mais plutôt à figurer l’innocence héroïque du temps présent. Cette peinture mythologique veut élever l’action ou le désir humain à l’idée, à l’absence de mouvement et à l’éternité des images. Elle veut conjurer sa propre superficialité en mimant l’épaisseur minérale : graver le nom de l’Homme dans la pierre, de même que la signature de son artisan. Tout le néoclassicisme est le rêve de pierre d’une beauté héroïque, un désir de modernité qui veut saisir le présent en le mythifiant et qui, ce faisant, se condamne à le fuir, à poursuivre son idéal hors de l’histoire, dans les moites chaleurs des harems. Œdipe est ici l’homme nouveau, dont le pouvoir consiste justement à rejeter dans un passé de légendes les monstres qui voudraient terrifier la raison. Il marque l’avènement d’un siècle où la raison se veut conquérante, où, selon la formule d’Auguste Comte, savoir c’est pouvoir. Il est le Moderne dont la science surmonte la sagesse des Anciens. Le Thébain qui s’enfuit à l’arrière-plan en est le symbole, lui, l’Ancien, l’homme âgé, pris d’une terreur panique, infantile, face à une nature monstrueuse qu’il ne s’explique pas. Cet Œdipe est le frère de Prométhée, cette autre figure mythique dans laquelle le dix-neuvième se reconnaîtra et qu’il représentera de même déchargée de toute culpabilité, de toute ambiguïté tragique. Il n’y a ici nulle trace ni présages de son aveuglement. Il a le regard des dieux, il ne cille pas ; sa sagesse ignore tout de la suture du visible et de l’invisible, du savoir et de l’ignorance. C’est là peut-être d’ailleurs que réside l’aveuglement tragique de ce siècle, d’une raison qui devra attendre de se crever les yeux à sa propre barbarie pour en prendre la juste mesure. Mais nous sommes encore au temps de l’innocence, celui du bel éphèbe qui ne tremble pas devant le monstre. C’est donc l’âge de l’homme que célèbre Ingres, un homme qui, par sa disproportion, semble avoir pris la place qu’occupait la divinité dans les perspectives symboliques du Moyen-Age et de la Renaissance, quand le monstre, et l’énigme qu’il incarne, sont réduits à des proportions dérisoires et bien peu terrifiantes. Ce rêve de pierre est un rêve d’empire ; le héros solaire est aussi le héros porte-lances qui accomplit l’alliance du savoir et du pouvoir. Ingres rejoint ici la vérité du siècle à venir en figurant son mythe, le rêve d’une conciliation des Lumières et des empires, d’une raison civilisatrice, qui croira encore en son innocence jusques dans la violence la plus cauchemardesque. Le héros solaire triomphe mais il est étrangement solitaire, lui dont l’aura ne procède que de lui-même. On ne peut contempler longtemps la toile d’Ingres sans éprouver le vertige de ce solipsisme dévorant. Car la certitude de cet Œdipe est celle d’un héros sans monde, qui ne connaît que ce qu’il soumet.
Qu’est-ce que peindre Œdipe et le sphinx après Ingres ? Comme nous l’avons souligné, l’originalité de la démarche de Bacon consiste à inscrire les images dans l’Histoire, non pas au sens où il exprimerait sa dette envers une tradition dont il hérite, mais plus essentiellement en exposant les images elles-mêmes au devenir. Les icônes sont ainsi conduites par le peintre au lieu du sacrifice où elles subissent soudain les avanies du temps, métamorphosées selon une déformation dont les principes leur échappent, devenant les témoins hallucinés d’une logique qui ne livre pas son secret. Aussi l’œuvre de référence ne joue-t-elle jamais comme un modèle qu’il s’agirait simplement d’imiter ou de renouveler ; Bacon cherche au contraire à tirer les images hors de leur éternité mythifiée pour leur donner vie, leur conférer une durée, les faire et nous faire les témoins du travail du temps. Ingres n’est donc pas l’objet essentiel que Bacon poursuit : son unique parangon, celui dont il veut saisir le vibrion incessant, c’est l’œuvre de l’Histoire elle-même, la façon dont elle transforme le visage de l’homme, ses images. La relation qui s’instaure dès lors entre les deux œuvres ne participe pas d’une logique de l’imitation, de l’identité et de la différence, mais implique le devenir historique du mythe lui-même, ce que sont devenus Œdipe et l’image que nous nous en faisons depuis Ingres. En ce sens, regarder une toile de Bacon, ce n’est pas se demander ce que le peintre fait des modèles qu’ils convoquent, mais interroger le destin de nos images et de nos mythes, se demander ce que nous avons fait d’elles, dans quelle histoire nous les avons entraînées. Ce déplacement de perspective change complétement le statut de l’image : de représentation aveugle elle devient en effet un témoin, qui expose les stigmates de sa finitude, qui nous regarde et nous demande raison de ce devenir énigmatique. Toutes les toiles de Bacon sont des énigmes qui semblent en attente de leur impossible déchiffreur.
Que
s’est-il passé après
Ingres ?
Que sont devenus Œdipe
et le sphinx ?
Le titre nous contraint ainsi à tirer le mythe et sa représentation
hors du ciel des idées, à se les figurer comme porteur d’une
histoire et témoins de notre Histoire. L’image et le mythe se
voient attribués une vie propre : le héros et le monstre
semblent avoir poursuivi ensemble leur chemin, soumis l’un l’autre
à la nécessité et aux vicissitudes d’une histoire qu’ils
livrent à notre regard. La préposition « après »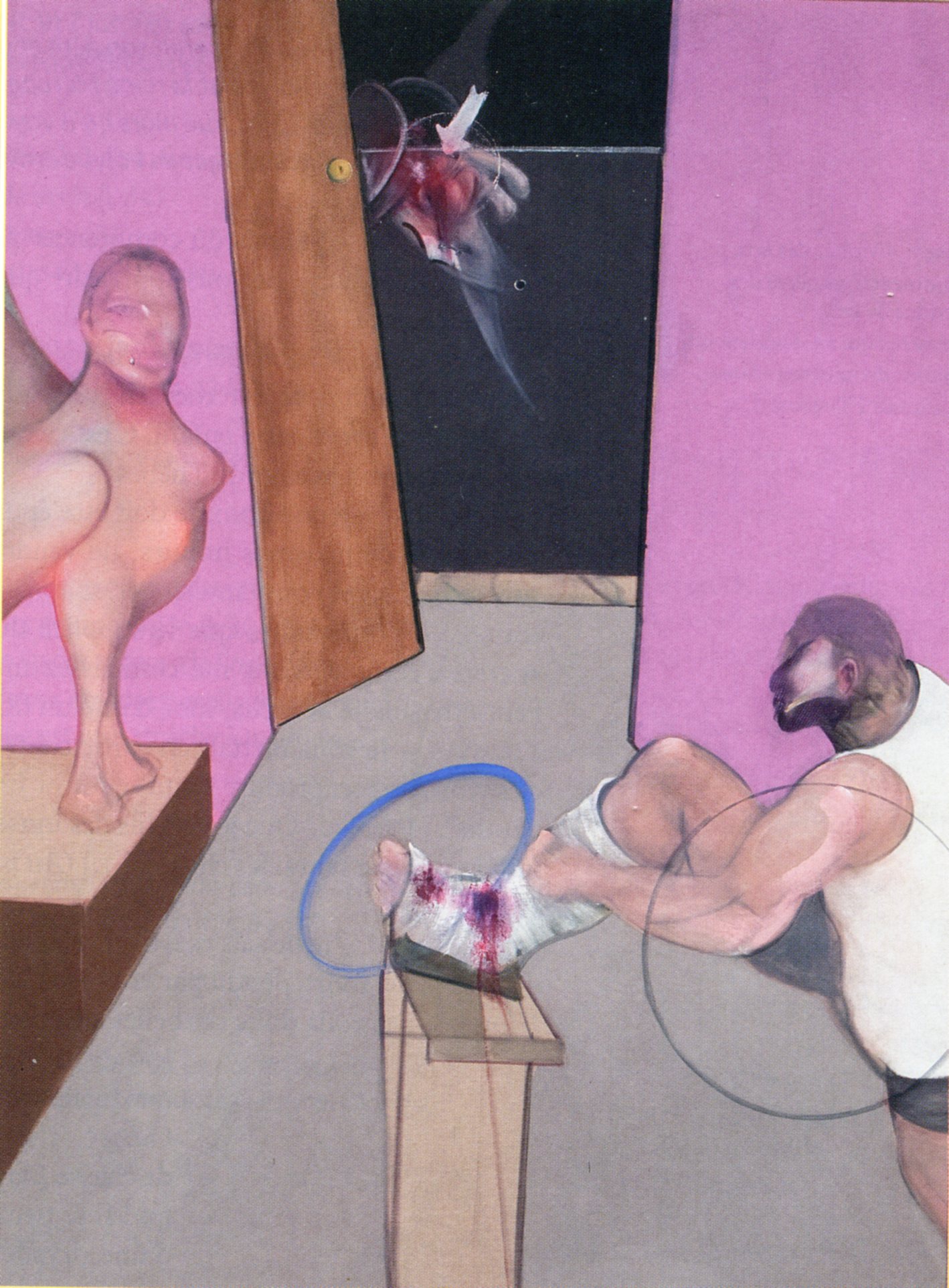 peut prendre aussi une autre résonnance : elle confère à
l’œuvre d’Ingres la valeur d’une origine, d’un commencement
glorieux, que le temps ne pourrait que corrompre et trahir et qui
nous condamnerait à la nostalgie. En ce sens, peindre Œdipe
et le sphinx après
Ingres, ce serait se mettre en quête d’une innocence et d’un
idéal perdus : après Ingres, on ne pourrait plus peindre le
mythe sans singer ou gauchir le geste triomphal du maître. On ne
peut ignorer ce sens possible mais, comme nous le verrons dans
l’interprétation de la toile de Bacon, cette révérence a la
couleur de l’ironie, une ironie qui ne s’adresse pas tant à
Ingres lui-même qu’à l’Histoire dont il est le peintre et le
chantre aveugle.
peut prendre aussi une autre résonnance : elle confère à
l’œuvre d’Ingres la valeur d’une origine, d’un commencement
glorieux, que le temps ne pourrait que corrompre et trahir et qui
nous condamnerait à la nostalgie. En ce sens, peindre Œdipe
et le sphinx après
Ingres, ce serait se mettre en quête d’une innocence et d’un
idéal perdus : après Ingres, on ne pourrait plus peindre le
mythe sans singer ou gauchir le geste triomphal du maître. On ne
peut ignorer ce sens possible mais, comme nous le verrons dans
l’interprétation de la toile de Bacon, cette révérence a la
couleur de l’ironie, une ironie qui ne s’adresse pas tant à
Ingres lui-même qu’à l’Histoire dont il est le peintre et le
chantre aveugle.
Quel est donc ce visage du temps, cet « après », que Bacon veut ici saisir ? Ce qui frappe, à la première vision de son œuvre, c’est l’évidente trivialité de la scène. Si le dispositif reste assez similaire à l’image d’Ingres dans la position d’ensemble des personnages, imposant ainsi avec évidence la référence, on ne peut éprouver d’emblée qu’un sentiment d’incongruité devant cette image. En chemin, Œdipe et la Sphynge semblent s’être dépouillés de tout l’apparat héroïque qui donnait à leur confrontation une dimension mythique. Si le monstre garde ses attributs chimériques, ailes et pattes, ceux-ci sont à peine esquissés par des traits schématiques et statiques, peu susceptibles de susciter un sentiment panique, ce que renforce le rose uni d’une chair imberbe, couleur poupine et bien peu terrifiante. Œdipe, quant à lui, a délaissé sa nudité idéale de héros antique pour revêtir une tenue de sportif du dimanche, short et marcel. Quant au décor, le spectacle grandiose d’une nature magnifiée s’est dissipé pour laisser place à une installation des plus sommaires : des pans de murs, tout de guingois, qui évoquent soit un décor théâtral, soit une salle d’attente d’un cabinet médical, une estrade et un chevalet de bois brut. Nous avons quitté le décorum néoclassique d’une extériorité sauvage et épique pour une intériorité mal jointée, branlante. Œdipe et la Sphynge semblent avoir rejoint un non-lieu dont le dépouillement n’est pas sans évoquer la dramaturgie contemporaine, notamment le théâtre de l’absurde. Le bel éphèbe porte-lances d’Ingres a laissé place à un pauvre hère aux traits effacés, simiesques, indistincts ; le héros solaire qui célébrait l’âge de l’homme s’est mué en un plébéien sans visage et sans gloire. Après Ingres, Œdipe semble avoir perdu sa souveraineté superbe : il n’est plus le héros aux dimensions divines qui écrase le monstre de sa présence et s’empare de l’énigme. L’Œdipe de Bacon a cessé d’être le centre lumineux devant lequel le monde se ploie ; il n’est plus le déchiffreur d’énigmes qui soumet le monstre au tribunal de sa raison. Le geste triomphal qui occupait le centre de la toile d’Ingres a disparu. L’alliance du savoir et du pouvoir a été rompue. Le maître du logos s’est changé en un suppliant qui expose ses plaies sanguinolentes, comme s’il était dans l’attente d’une guérison qui lui semble refusée. Car il ne s’agit plus d’un face-à-face : décentré, Œdipe s’est éloigné de la Sphynge et la distance qui semble s’être creusée entre eux est renforcée par l’indifférence apparente du monstre, dont le visage s’est détourné du héros pour fixer le spectateur. De même que le héros, le monstre s’est dépouillé de ses attributs mythiques et imaginaires, mis à nu en quelque sorte quand Œdipe, lui, s’est rhabillé. De provocante et terrible qu’elle était chez Ingres, la Sphynge semble s’être figée, réduite à une figure inoffensive et lointaine, ce que renforce l’effacement progressif de son visage, de même que celui du héros. Tout concourt ainsi a donné le sentiment d’une disparition de la scène mythique, d’un écrasement et d’une démystification de l’héroïsme tragique, égaré dans le prosaïsme et incapable de retrouver ses gestes. L’affrontement s’est mué en une pantomime, celle de deux solitudes qui ne se rejoignent pas. Le sacre des Lumières a fait place au pathétique d’une souffrance ignorée.
Après Ingres, l’homme semble avoir perdu la confiance qu’il avait dans les images de sa grandeur. Par rapport à la scène originelle, celle d’Ingres, un curieux renversement s’est donc produit : le sujet souverain, qui soumettait par sa parole la nature entière, semble maintenant quémander une réponse, une raison pour ses souffrances, qu’il n’obtient pas. La Sphynge semble retrouver son pouvoir oraculaire mais un oracle qui ignore désormais le héros. Et en même temps, elle apparaît comme une figure dérisoire, un fétiche des temps anciens. Car les réponses sont là, soulignées de façon ostentatoire, par des cercles analytiques, précis et objectifs, qui unissent la souffrance et le sexe, rendant inutile le dialogue avec le monstre. La force de l’œuvre de Bacon consiste ainsi à conjoindre à la fois l’épuisement et le retour de l’énigme tragique, faisant de cette ambiguïté, comme nous allons le voir, le miroir de notre modernité.
Epuisement du tragique - Il n’y a plus d’énigme, plus de questions dont l’animal rationale ne puissent trouver la réponse, et Bacon semble ainsi parachever l’avènement de cet âge de l’homme, de ce savoir souverain, que la toile d’Ingres annonçait. Les cercles, dans la toile, sont cercles de science ; ils prescrivent un sens, imposent une explication qui ordonnent le regard du spectateur et le dépossèdent de sa liberté d’interprétation. Par l’usage de ces signes, de même que par l’effacement des visages, Bacon semble soumettre ses propres images à une logique de la destruction, comme s’il s’agissait de raturer ou de souligner tous les effets de sens dont notre regard est captif et qui s’interposent entre le visible et nous. C’est la logique des signes que Bacon cherche ici à piéger dans l’image elle-même pour en désamorcer la mécanique aveugle. Car ces cercles anticipent le discours que nous plaquons sur les images et qui nous crèvent immanquablement les yeux. Ils pointent les lieux communs d’une modernité qui, par le biais de la psychanalyse, a cru épuiser l’énigme tragique en la réduisant à un complexe. Pris par la logique des signes, le regard ne peut s’empêcher en effet de tisser un rapport de causalité entre les deux cercles, la souffrance d’Œdipe, que le premier cercle entoure, trouvant son explication dans son sexe, qui, sans être vu, occupe le centre du second, ou bien encore inversement, la sexualité d’Œdipe s’expliquant par sa blessure d’enfance. L’Œdipe moderne a cessé ainsi d’être une énigme pour lui-même ; cerclé par l’analyse, il est expliqué, le corps souffrant se résolvant en figures mathématiques qui expurgent la scène tragique. Nous sommes donc bien dans un cabinet médical, la salle d’attente ripolinée de rose d’un psychanalyste. Œdipe a cessé de séjourner dans une nature toute artificieuse, mythique et néoclassique, pour rejoindre un autre artifice, celui d’une intériorité vide et de mauvais goût, où le héros sublime d’Ingres s’est métamorphosé en un patient, un suppliant qui semble attendre, pitoyable, qu’on le décharge de sa souffrance. Car il n’est plus que cela l’Œdipe moderne : une souffrance anonyme, un animal blessé en quête de thérapie et son visage déjà se déforme, prend des allures simiesques. La geste puérile du raisonneur d’Ingres a laissé place aux geignements plaintifs de la bête. Les signes chirurgicaux éclairent en contrepoint l’attitude dédaigneuse de la Sphynge, rendue inutile tout autant que l’énigme par les certitudes d’un homme qui croit trouver par lui-même une explication à son destin. Au beau milieu de cette modernité objective aux odeurs d’éther, le monstre se fige en une figurine de cire inoffensive, exposée sur son estrade comme une bricole de musée. Ses traits s’effacent. La Sphynge est sur le point de disparaître.
Retour du tragique - Mais, au beau milieu de cette dissolution, demeure un regard têtu qui fixe le spectateur et accroche d’autant plus son regard qu’il est presque imperceptible, au contraire des cercles dont le caractère ostentatoire trahit la superficialité. Nous sommes embarqués. Par ce regard qui nous convoque d’autant plus qu’il semble pris dans un mouvement, saisi au passage, la Sphynge reconquiert son statut d’oracle, mettant le spectateur dans la position d’Œdipe lui-même, faisant de lui le véritable destinataire de l’énigme. Rappelons quel était le dispositif d’exposition que Bacon souhaitait pour ses œuvres : les toiles devaient être exposées sous des vitres réfléchissantes, de telle manière que le spectateur se voit lui-même en regardant la toile. Face à Œdipe et le Sphinx après Ingres, une telle mise en scène prend un sens décisif, le regard de la Sphynge étant redoublé et confirmé par ce miroir qui rend visible le spectateur à ses propres yeux. Soudain, l’œuvre se fait ainsi témoin et nous fait témoin d’une énigme qui s’adresse à nous. Nous sommes mis au défi et l’image tout entière, par ce regard qui se détourne du héros pour se tourner vers nous, se métamorphose en un piège qui accuse ses propres faux-semblants, qui ne sont autres que ceux de notre Histoire, d’une représentation de l’homme qui a cru en épuiser le sens, et qui nous conduit ainsi jusqu’au point de notre aveuglement. Les cadres de la représentation se brisent, cédant sous les règles pourtant classiques d’une perspective qui distend l’image selon une double profondeur, celle de notre regard, tiré de son invisibilité souveraine, et bientôt happé, entraîné à traverser les divers plans de l’image vers ce point de fuite, où nous rejoignons la nuit de l’énigme. Comme Œdipe, cheminant lentement vers ce qu’il ne veut et ne peut pas voir, nous avançons vers ce seuil. Elle est là, informe, innommable, elle nous attend, et nous ne pouvons pas plus lui échapper que nous ne pouvons libérer notre regard des lois implacables de la perspective. Le regard de la Sphynge nous entraîne fatalement, mécaniquement, vers le fond de l’image qui lui fait contrepoint, ce seuil, cette porte qui s’ouvre sur la nuit et sur l’informe. Ironie du destin, de tout destin : Nous sommes ramenés au tragique, que nous pensions avoir épuisé, par les règles les plus classiques de la représentation elle-même, qui ordonnent notre regard avec autant de nécessité que le destin d’Œdipe, conduit au seuil d’une vérité qui l’aveuglera. Le tragique chez Bacon s’inscrit ainsi au cœur même des lois qui régissent le visible et font de sa logique elle-même notre aveuglement. Le peintre ne veut pas nous faire voir quelque chose, ni même rendre visible l’invisible. Il veut crever le visible. Il veut nous crever les yeux.
L’oracle nous regarde. Et ce regard dit la persistance de l’énigme, son irrésolution. Nous nous transformons en témoins d’une question que nous n’entendons pas, d’une réponse que nous ignorons. Soudain, l’image se métamorphose et prend un tout autre sens. L’achèvement de l’âge des Lumières qu’inaugurait Ingres avec une naïveté néoclassique se fissure pour laisser sourdre une origine tragique que ni le savoir, ni le pouvoir humains n’ont réussi à épuiser. Cet « après Ingres », si l’on y prend garde, est un avant Ingres. Au beau milieu d’une mise en scène en apparence moderne, Bacon figure un Œdipe des origines, qui réintroduit les indices du tragique, quand l’utopie d’Ingres les effaçait. Car Œdipe qui, par son nom, est celui qui sait, et tel qu’il n’est chez Ingres que ce savoir souverain, triomphant, retrouve avec Bacon l’autre résonnance de son nom, celle-ci tragique : il est celui qui boîte, celui qui porte sur lui la marque infâmante du tragique, que rien ne saurait effacer. Le bel éphèbe, le héros de lumière, qui célébrait la jeunesse insolente de l’homme nouveau, plus révolutionnaire qu’antique, redevient le boiteux, le porteur de destin, qu’il aurait voulu n’avoir jamais été. L’Histoire est une fuite mais on n’efface pas le tragique. Le décor moderne laisse place à une scène archaïque. Nous ne sommes plus dans l’officine thérapeutique du psychanalyste mais sur une scène de théâtre, la scène originelle du sacrifice. Le tréteau de bois brut qui occupe le centre de la toile, où Œdipe expose sa blessure, est l’autel du bouc, l’autel du sacrifice. Et ces murs, tout de guingois et branlants, dévoilent leur illusion et leur vérité : ce sont les décors d’un théâtre, figures d’une autre représentation où l’homme, au lieu de se fuir dans et par les images, affronte sa souffrance ineffaçable.
La perspective, le regard en contrepoint de la Sphynge, comme les lignes de force de l’œuvre, nous entraîne dès lors vers le fond de la toile, vers cette porte ouverte, vers la nuit de l’énigme. Une flèche semble nous indiquer que c’est là, que nous « brûlons », comme disent les enfants, que nous touchons enfin au but où toutes les questions tragiques trouvent enfin leurs réponses. Mais, ironie de ce signe, il nous ordonne de voir ce que nous n’arrivons pas à voir. Une forme apparaît mais semble se dérober à toute nomination, s’échapper au moment même où l’on croit commencer à la discerner. C’est une chair d’autopsie, c’est la chair que l’autopsie n’a pu résorber et qui demeure, au fond, obscène. Matière pure et sans forme définie, le regard qui s’y attarde s’y perd : bien des chimères sur le point de s’en extraire se dissipent quand on tente de les retenir. Voilà le point de notre aveuglement. Comme pour les anciennes anamorphoses, on voudrait changer de perspective pour trouver le lieu exact où le sens et la forme se révéleront. Mais on a beau tourner autour de l’œuvre, ce point se dérobe et la seule chose que nous voyons, c’est notre reflet fantomatique, réfléchi par la vitre d’exposition, fixé par le regard de la Sphynge auquel nous n’échappons pas.
Le tragique se loge tout entier dans ce jeu de miroir. Sur cette forme énigmatique que notre regard interroge et qu’il ne peut déchiffrer, flotte un visage, le nôtre. Cette forme indécidable, comme saisie dans le mouvement d’une métamorphose inachevée, cette matière en souffrance d’un nom et d’un sens, c’est la vérité tragique de l’homme, au reflet de sa propre énigme. La nuit vers laquelle nous sommes conduits par l’œuvre est un à-plat sans ombre ni profondeur : l’énigme est une surface qui réfléchit notre regard et qui renverse le rapport du voyant et du visible. Cette œuvre nous dévisage. Cet entre regard prend chez Bacon un tout autre sens que celui qu’il pouvait avoir dans la peinture classique, où, par le jeu de la reconnaissance, il confirmait le don de l’œuvre, son épiphanie, sa visibilité et sa signification. Ici, le regard de la Sphynge sanctionne au contraire la débâcle du sens, l’impuissance de l’homme à déchiffrer sa propre énigme, à trouver dans ses représentations une certitude d’être. Et, par ce renversement, l’image acquiert soudain une vie mystérieuse, autonome : ce que Bacon nous donne à voir, ce n’est pas une nouvelle image de l’homme mais la façon dont nos images sont travaillées, déformées par un destin et une histoire dont elles sont les témoins impuissants. C’est ce devenir, ce « jeu insensé » de l’Histoire, auquel nous sacrifions nos mythes, que le regard de la Sphynge interroge. Les métamorphoses qui affectent les images de Bacon deviennent ainsi le juste reflet d’une Histoire sans finalité, où l’homme s’échappe à lui-même, où ses propres images s’éloignent, pour devenir les témoins de son aveuglement.
Après Ingres – Deux siècles, deux figures d’Œdipe. Bacon figure le destin de l’homme au travers du destin de ses images. Avec Ingres, on assiste au triomphe de la représentation, précision du dessin et certitude des desseins humains qu’incarne le déchiffreur d’énigmes, maître du savoir et des signes, le héros des Lumières, qui fait la leçon au monstre terrifié. Un siècle a passé. Le temps et l’histoire ont travaillé la représentation, livrant leur propre énigme, celle d’un mouvement qui parachève les possibles et, inversement, fait régresser le progrès vers l’origine. L’humanité est délivrée du mythe, de la nature, de l’archaïsme, du merveilleux comme du monstrueux. Le savoir ne requiert plus de héros. Les signes triomphent, ceux d’une science qui convertit le tragique en symptômes ; la Sphynge est une pâte molle ; rien ne demeure que le constat d’un mal en attente d’être traité. Mais soudain l’archaïque perce la clinique. Les signes perdent leurs vertus opératoires ; les évidences chirurgicales se muent en obscénités. Œdipe, sa boîterie, son sexe et sa chair, l’Œdipe simiesque, sans regard, aveuglé non pas d’avoir fait face à sa vérité tragique mais de croire qu’elle peut être soignée. Il y a tant d’ironie dans ce regard à demi effacé de la Sphynge qui renvoie celui qui voit à sa propre énigme. Nos images nous regardent. C’est cette vérité aveuglante à laquelle nous conduisent le mythe et la tragédie.
[i] Nous renvoyons ici à l’essai de Monique Dixsaut, Platon, « La cité et le monde », Vrin, pp. 232-237 pour la référence présente et les suivantes.
[ii] La traduction à laquelle nous nous référons, ici et par la suite, est celle de Gaston Leroux, GF Flammarion, 2002.
[iii] Cf. La quête d’Averroës, Jorge Luis Borges (in L’aleph, Gallimard, L’imaginaire, pp.117-130).
[iv] Cf. « Œdipe sans complexe » in Œdipe et ses mythes, Editions complexes, p.5.
[v] In Théétète, 152d.
[vi] In La prudence chez Aristote, PUF Quadrige, pp.95 et suivantes.
[vii] Car tel est bien l’effet remarquable de la « reconnaissance » tragique, comme le souligne Vernant, reprenant la définition d’Aristote : « La clé de voûte de l’architecture tragique, le modèle qui sert comme de matrice à son organisation dramatique et à sa langue, c’est le renversement, c’est-à-dire le schème formel d’après lequel les valeurs positives s’inversent en valeurs négatives, quand on passe de l’un à l’autre des deux plans, humain et divin, que la tragédie unit et oppose, comme l’énigme, d’après la définition d’Aristote, joint ensemble des termes irréconciliables » (« Ambiguïté et renversement. Sur la structure énigmatique d’Œdipe-roi », in Œdipe et ses mythes, Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, Editions complexes, p.32)
[viii] Les ruses de l’intelligence. La mètis des Grecs, Champs essais, p.55.
[1] Ambiguïté et renversement. Sur la structure énigmatique d’ « Œdipe-Roi » (in Œdipe et ses mythes, Editions complexes, p. 29-31)
[2] Le sujet tragique : historicité et transhistoricité (in Mythe et tragédie en Grèce ancienne, Editions La Découverte, p.85)
[3] Il est curieux d’ailleurs que l’on ait figuré la philosophie (platonicienne) comme une espèce d’avènement de la pensée, alors qu’elle est plutôt la marque d’un ascendant de la volonté, d’une volonté d’ordre, sur la pensée, cette dernière devenant sa servante. Ce qui bien sûr n’échappe pas à Nietzsche.
[4] Œdipe à Athènes (in Mythe et tragédie en Grèce ancienne, p.169)
[5] L’Œdipe dont nous parlons ici est évidemment celui de Sophocle.